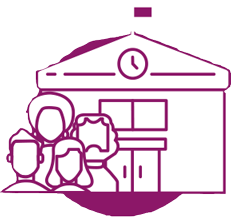Ne proposez pas toujours les activités aux mêmes résidents : l’animation doit se montrer accessible à tous et prendre le temps d’encourager les personnes à participer, ce qui est partie prenante de la démarche du projet d’animation.
Ne persévérez pas dans une activité qui semble ne plus fonctionner : une fois constaté sa faible attractivité, il ne faut pas hésiter à mettre en place une autre proposition. De ce point de vue, l’animateur doit procéder à des bilans réguliers.
N’oubliez pas que l’animateur ne peut tout faire seul : des prestataires extérieurs, des bénévoles et l’équipe interne sont partie prenante de l’activité.
FAQ sur le programme d’animation en Ehpad
Pourquoi est-il important de lier le programme d’animation au projet d’établissement ?
Cela garantit que les activités répondent aux besoins des résidents, favorisant leur bien-être et renforçant les liens sociaux et l’autonomie, en cohérence avec les valeurs de l’établissement.
Comment l’animateur peut-il adapter les activités aux intérêts des résidents ?
L’animateur peut explorer de nouvelles pratiques, s’inspirer de collègues ou inviter des intervenants spécialisés pour répondre aux préférences variées des résidents.
Quelles activités conviennent aux résidents atteints de troubles cognitifs ?
Des activités du quotidien comme le pliage de linge ou des ateliers corporels renforcent l’autonomie et offrent un effet thérapeutique, favorisant bien-être et dignité.
Comment mesurer la satisfaction des résidents envers le programme d’animation ?
En réalisant des bilans mensuels, l’animateur recueille des données sur la participation et la satisfaction, ajustant le programme en fonction des retours.
Comment garantir la communication autour des activités proposées ?
Une communication claire et adaptée (affichages visibles, annonces pendant les repas) ainsi que l’implication des équipes assurent une large diffusion du programme.




















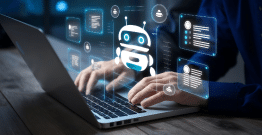









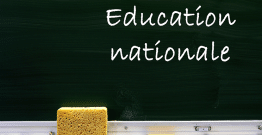







![[ép. 221 n° double] Responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) : bilan et changements](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-221-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-publics-rfgp-bilan-et-changements-300x161.png)
![[ép. 220] Handicap et fonction publique : 20 ans après…](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-220-handicap-et-fonction-publique-20-ans-apres-300x161.jpg)
![[ép. 219] Risques psychosociaux : prévenir, c'est aussi se protéger… soi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-219-risques-psychosociaux-prevenir-c-est-aussi-se-proteger-soi-300x161.png)