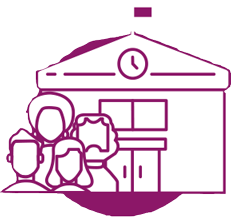S’il fallait définir d’un mot l’évaluation, l’on pourrait dire qu’évaluer, c’est d’abord comprendre le travail réalisé, ses qualités comme son utilité. Plus précisément, il s’agit de :
- produire de la connaissance ;
- analyser les informations qui en résultent pour apprécier les actions conduites ;
- faciliter les décisions relatives aux actions pour améliorer le service rendu.
Cette logique évaluative trouve à s’appliquer à divers processus, qui se distinguent notamment par leurs finalités. Par exemple, faire un rapport annuel d’activité, c’est regarder ce qui s’est passé (mise à jour de connaissances), l’analyser et l’apprécier (ce qui a marché, ce qui n’a pas marché, ce qui pose problème…) pour en tirer des pistes d’actions. Il en va de même lorsque l’on prépare un projet d’établissement (état des lieux, analyse critique, stratégie d’action).
Deux éléments ressortent de cette première approche :
- l’évaluation n’est pas une pratique totalement nouvelle pour les Ehpad ;
- mais il est nécessaire de bien comprendre ce à quoi les dispositions de l’article L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles nous invitent : évaluer les activités et la qualité des prestations.
A noter
Les activités développées par un Ehpad et les prestations délivrées peuvent être regardées comme un ensemble d’actions visant à la réalisation d’objectifs définis. Cela signifie que l’évaluation consiste à mettre en relation les objectifs fixés et les actions développées pour les réaliser.
Ces objectifs découlent des missions imparties. Mais ces dernières sont souvent définies dans la loi (article L. 311-1 du Code de l’action sociale et des familles ou dans les schémas, par exemple) de façon assez générale. C’est, en fait, dans le projet d’établissement, ou dans le projet de vie, que l’on retrouve les objectifs plus précis, établis par chaque Ehpad. D’un certain point de vue, le projet est un document de « traduction » concrète des missions imparties.
Dès lors, le projet représente un point d’appui essentiel pour toute évaluation. Mais cela n’est pas suffisant.
En effet, les actions mises en œuvre pour réaliser les objectifs fixés ont pour finalité de produire des effets sur la situation des usagers.
Là aussi, la loi ne fait qu’en définir les grands traits comme la promotion de l’autonomie, de la protection des personnes, de la cohésion sociale, de l’exercice de la citoyenneté, de la prévention des exclusions et de la correction de leurs effets (article L. 116-1 du Code de l’action sociale et des familles).
A noter
Ainsi, on peut dire que l’évaluation, telle qu’elle ressort de la loi du 2 janvier 2002, consiste à connaître, à analyser et à apprécier ce que réalise un Ehpad autour du triptyque : objectifs – actions – effets.
Reste que la question des effets a soulevé et soulève encore des interrogations, particulièrement chez les professionnels de terrain. De quoi peut-il s’agir ?
En réalité, tous les professionnels, le plus souvent en équipe, s’interrogent quasi quotidiennement sur les effets des actions qu’ils mènent. Cela a-t-il fonctionné ? La situation a-t-elle évolué ? Est-ce dans le sens où nous le souhaitions, et si cela n’a pas marché comme on le voulait, pourquoi ?
En ce qui concerne les effets sur la situation des usagers, l’évaluation, au sens de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, nécessite que les établissements et les équipes :
- énoncent les critères mis en place ou couramment utilisés pour apprécier la réalisation des objectifs fixés ;
- précisent la façon dont sont examinées les situations particulières, les événements dits « indésirables » ;
- décrivent les outils utilisés (réunion de synthèse, études de cas, supervision, rencontres avec les résidents, les familles, procédure de déclaration d’incident…).
En résumé, les établissements et les équipes déterminent eux-mêmes les critères sur lesquels ils apprécient le travail réalisé, les effets sur la situation des usagers et les moyens qu’ils se donnent pour cela.




















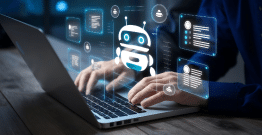









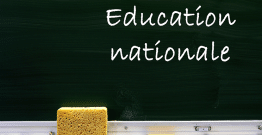







![[ép. 221 n° double] Responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) : bilan et changements](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-221-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-publics-rfgp-bilan-et-changements-300x161.png)
![[ép. 220] Handicap et fonction publique : 20 ans après…](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-220-handicap-et-fonction-publique-20-ans-apres-300x161.jpg)
![[ép. 219] Risques psychosociaux : prévenir, c'est aussi se protéger… soi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-219-risques-psychosociaux-prevenir-c-est-aussi-se-proteger-soi-300x161.png)