Partie 1 - Les structures extrahospitalières
Chapitre 1 - L’hospitalisation à domicile (HAD)
1.1/3 - HAD et spécialités
- 1.1/3.1 - HAD en psychiatrie
- 1.1/3.1.1 - Le contexte juridique
- 1.1/3.1.2 - Les pathologies psychiatriques traitées en HAD
- 1.1/3.1.3 - Les bénéficiaires
- 1.1/3.1.4 - Quels sont les modes d'admission ?
- 1.1/3.1.5 - Quels sont les dispositifs extrahospitaliers en psychiatrie ?
- I - Le secteur et les alternatives à l'hospitalisation
- II - Le rôle des centres médico-psychologiques
- III - L'hospitalisation de jour et l'hospitalisation de nuit
- IV - La coordination entre le médecin psychiatre et ses confrères libéraux
- V - Vers une synergie entre les établissements de santé traditionnels et les établissements de santé spécialisés en psychiatrie
- 1.1/3.1.6 - Quelques expériences : une expérience d'HAD en gérontopsychiatrie
- I - Introduction
- II - L'année 1985
- III - Les années 1985-1988 : les « troubles du comportement » et leur contexte
- IV - Les années 1988-1991 : du secteur au réseau
- V - L'année 1992 : un réseau informel et une prédominance du travail ambulatoire
- VI - Nous sommes un facteur psychosocial modulateur...
- VII - Comment penser le soin et l'aide face aux troubles psycho-compormentaux ?
- VIII - Apprendre à conjuguer différentes logiques
- 1.1/3.2 - HAD en pédiatrie
- 1.1/3.3 - HAD et affections pulmonaires
- 1.1/3.4 - HAD et oncologie
- 1.1/3.4.1 - Le contexte juridique
- 1.1/3.4.2 - Les pathologies cancéreuses traitées en HAD
- 1.1/3.4.3 - Soins de support et cancer du sein : impact d'une prise en charge socio-esthétique
- 1.1/3.4.4 - Les bénéficiaires
- 1.1/3.4.5 - Quels sont les modes d'admission ?
- 1.1/3.4.6 - Quelques exemples
- 1.1/3.4.7 - Le réseau des malades et des proches : état actuel, objectifs et actions
- 1.1/3.4.8 - Les alternatives à l'hospitalisation conventionnelle en neuro-oncologie
- I - Champs d'investigations de la neuro-oncologie
- II - Les alternatives à l'hospitalisation traditionnelle
- III - Les options et les choix
- IV - Caractéristiques des patients de la cohorte suivie en HAD
- V - Quelles sont les chimiothérapies possibles en HAD ?
- VI - Les directives du Plan cancer
- VII - Un exemple de parcours de soins pour un cas fréquent : patient adulte atteint de glioblastome
- VIII - La fin de vie et le décès
- 1.1/3.4.9 - Un réseau régional de cancérologie : illustration en Aquitaine
- 1.1/3.4.1 - Le contexte juridique
- 1.1/3.5 - HAD et soins palliatifs chez l’adulte
- 1.1/3.5.1 - Le contexte juridique
- 1.1/3.5.2 - Les soins palliatifs en HAD
- 1.1/3.5.3 - Les bénéficiaires
- 1.1/3.5.4 - Quels sont les modes d’admission ?
- 1.1/3.5.5 - Quelques exemples
- I - Douleurs cancéreuses et non cancéreuses
- II - L'articulation avec les centres et consultations de la douleur
- III - Santé et formation : vers l'éducation thérapeutique des patients
- IV - Formation des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur
- V - Les agents et techniques analgésiques
- VI - Matériel pour antalgie : procédures d'utilisation
- VII - Prise en charge de la douleur iatrogénique au domicile et chez le patient en ambulatoire
- 1.1/3.5.1 - Le contexte juridique
- 1.1/3.6 - HAD et maladies neurologiques
- 1.1/3.7 - HAD et périnatalité
1.1/3.1 - HAD en psychiatrie
1.1 - Le contexte juridique
Les professionnels de la psychiatrie ont une solide expérience en matière d'alternatives à l'hospitalisation. Le principe même de la sectorisation psychiatrique repose sur l'intervention sur une aire géographique déterminée. L’HAD psychiatrique reste une spécificité dont les conditions d'exercice sont précisées par la circulaire du 4 février 2004 relative à l'hospitalisation à domicile. Elle précise : le rôle et les objectifs de l'HAD en psychiatrie, les modalités de prise en charge et les éléments de cadrage pour l'élaboration des projets.
Circulaire DHOS/O no 2004-44 du 4 février 2004 relative à l'hospitalisation à domicile : la partie IV et l'Annexe concernent l'HAD en psychiatrie.
Les professionnels de la psychiatrie possèdent une solide expérience en matière d'alternatives à l'hospitalisation.
Le principe même de la sectorisation psychiatrique repose sur l'intervention sur une aire géographique déterminée.
Toutefois, les deux axes fondamentaux explicités dans les paragraphes suivants doivent être rappelés.
I - Polyvalence de l'HAD
La psychiatrie peut désormais être incluse dans la gamme des disciplines médicales exercées au domicile du patient. Des formules de coopération doivent être développées. Ces formules sont explicitées dans les paragraphes suivants.
La psychiatrie peut se rapprocher des structures d'hospitalisation à domicile existantes, qu'elles soient publiques ou privées.
Tous les acteurs de la psychiatrie peuvent, par voie de convention, agréger leur discipline aux disciplines somatiques. L'époque où le public doit rester public et le privé cantonné dans son statut juridique est, espérons-le, définitivement révolue, au moins au point de vue juridique.
Les principaux obstacles restent culturels, et ce serait tout de même un comble que la psychiatrie cultive des obstacles psychologiques qui continueraient à limiter ses moyens et méthodes d'intervention.
Cette possibilité reste trop souvent méconnue et les professionnels des hospitalisations à domicile somatiques ne pensent pas ou hésitent à faire...








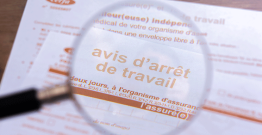










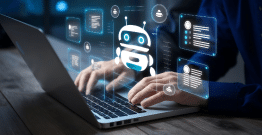










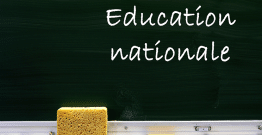







![[ép. 221 n° double] Responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) : bilan et changements](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-221-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-publics-rfgp-bilan-et-changements-300x161.png)
![[ép. 220] Handicap et fonction publique : 20 ans après…](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-220-handicap-et-fonction-publique-20-ans-apres-300x161.jpg)
![[ép. 219] Risques psychosociaux : prévenir, c'est aussi se protéger… soi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-219-risques-psychosociaux-prevenir-c-est-aussi-se-proteger-soi-300x161.png)
