Partie 4 - Droits et responsabilités
4/2 - Responsabilités
- I - Responsabilité morale
- II - Responsabilité déontologique et disciplinaire
- III - Responsabilité socio-économique
- IV - Responsabilité civile
- V - Responsabilité pénale
- VI - Sanctions
- VII - Principaux responsables en médecine du travail
- VIII - Conclusion
- IX - Pour une autre approche de la notion de responsabilité
Le médecin du travail s’expose dans sa pratique quotidienne et de façon personnelle à différents types de responsabilités. Ses inquiétudes légitimes à cet égard et ses interrogations trouveront des réponses claires dans ce chapitre qui distingue et développe les responsabilités morale, déontologique et disciplinaire, civile et pénale.
Le terme de responsabilité est souvent employé de façon générique. Cette terminologie recouvre une réalité plurielle, complexe, et certainement mal ou imparfaitement appréhendée par le médecin du travail.
Schématiquement, on doit tout d'abord et principalement, distinguer la responsabilité civile, qui oblige à réparation, et la responsabilité pénale, qui expose à des sanctions. À côté de cette distinction première, on doit également mettre en évidence d'autres formes de responsabilité, s'exerçant dans des domaines bien précis et qui concernent en tout premier chef le médecin du travail (responsabilité disciplinaire, responsabilité déontologique, responsabilité morale...).
Chacun de ces types de responsabilité comporte des règles particulières : les délais pour agir en justice sont différents, les juridictions ne sont pas les mêmes, etc.
Dans le secteur public, les services autonomes de médecine du travail sont soumis aux règles du droit administratif.
En principe, pour que la responsabilité professionnelle d'une personne soit engagée, il faut qu'elle ait commis une faute. Il faut, pour que la faute entraîne l'obligation de réparer, la conjonction de trois éléments : la faute, le dommage, le lien de cause à effet entre les deux. Si la responsabilité d'un sujet est engagée il doit une réparation. Cette réparation peut être la sanction de la faute pour l'auteur et/ou l'indemnisation de la victime du dommage. Cela explique qu'une même faute puisse éventuellement être jugée devant une juridiction civile ou pénale selon que le plaignant a saisi l'une ou l'autre de ces juridictions.
Une évolution des mœurs contribue à véhiculer l'idée selon laquelle tout dommage, quelles que soient ces caractéristiques, doit être indemnisé. Cette tendance reste néanmoins limitée sur le plan juridique strict, sauf dans le cas de l'aléa qui est désormais susceptible d'être indemnisé, mais dans des hypothèses qui seront sans doute rares en médecine du travail.
I - Responsabilité morale
La responsabilité morale...








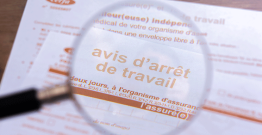










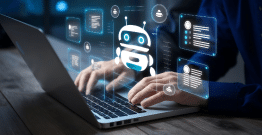










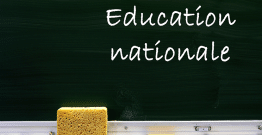







![[ép. 221 n° double] Responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) : bilan et changements](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-221-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-publics-rfgp-bilan-et-changements-300x161.png)
![[ép. 220] Handicap et fonction publique : 20 ans après…](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-220-handicap-et-fonction-publique-20-ans-apres-300x161.jpg)
![[ép. 219] Risques psychosociaux : prévenir, c'est aussi se protéger… soi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-219-risques-psychosociaux-prevenir-c-est-aussi-se-proteger-soi-300x161.png)
