Si le gestionnaire du domaine public – soit, le plus souvent, son propriétaire – peut économiquement le valoriser en accueillant des activités à but lucratif à travers l’utilisation de divers moyens juridiques permettant une occupation privative, cette liberté n’est, toutefois, pas inconditionnelle.
En effet, l’Administration se doit de respecter un certain nombre de principes essentiels.
Tout d’abord, il n’est pas possible d’accorder une autorisation dont le but ne serait pas compatible avec l’affectation du domaine.
Ensuite et surtout, lorsqu’elle décide d’octroyer une telle autorisation, elle doit veiller à respecter à la fois la liberté du commerce et de l’industrie, principe général du droit (CE, ass., 22 juin 1951, n° 00590 et n° 02551, Daudignac, Rec. 382), ainsi que le droit de la concurrence. Si le simple fait d’accorder une autorisation d’occuper le domaine public ne porte pas en soi atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, le respect de ce principe impose à l’Administration de ne pas restreindre, au-delà de ce qui est nécessaire ou justifié par l’intérêt général, l’initiative privée, et de n’intervenir dans le secteur marchand que lorsque l’intérêt public le justifie. Le respect de cette liberté est donc défini de manière négative : l’Administration ne doit pas, de quelque manière que ce soit, entraver l’initiative privée. De même, et au regard du droit de la concurrence, cette fois-ci, l’autorisation accordée d’occupation privative du domaine public à une société privée ne doit pas placer son titulaire dans une situation de nature à lui procurer un avantage susceptible de le favoriser par rapport à d’autres acteurs économiques.
En somme, l’occupation du domaine public n’est pas un droit, mais simplement une faculté que l’autorité administrative consent, à condition toutefois que cette occupation privative aux fins d’y exercer une activité économique soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine et ne fausse pas la concurrence.








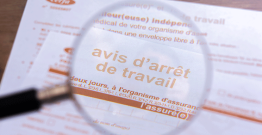










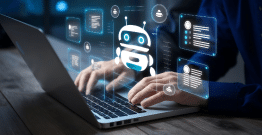










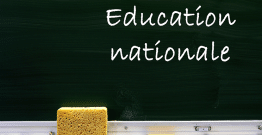







![[ép. 221 n° double] Responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) : bilan et changements](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-221-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-publics-rfgp-bilan-et-changements-300x161.png)
![[ép. 220] Handicap et fonction publique : 20 ans après…](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-220-handicap-et-fonction-publique-20-ans-apres-300x161.jpg)
![[ép. 219] Risques psychosociaux : prévenir, c'est aussi se protéger… soi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-219-risques-psychosociaux-prevenir-c-est-aussi-se-proteger-soi-300x161.png)

