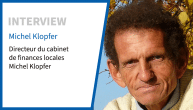Comment lutter contre les déserts médicaux ? C’est l’objet du rapport d’information sur les inégalités territoriales d’accès aux soins présenté le 13 novembre 2024 par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Un travail qui prolonge celui entrepris en 2022 sur le même sujet. Entretemps, la situation ne s’est pas améliorée malgré des timides avancées comme la loi Rist du 19 mai 2023 ou la loi Valletoux du 27 décembre 2023. Ainsi, en deux ans, la France a perdu 2 500 praticiens généralistes, portant leur nombre total à 99 500. « Les projections indiquent une poursuite de cette diminution jusqu’en 2028, avec l’atteinte d’un seuil critique des 92 500 praticiens », indique le rapport. Un constat qui a incité la commission a adopté 38 propositions afin d’améliorer l’accès aux soins des Français.
Conditionner les installations
La première proposition consiste à mettre fin à la liberté totale d’installation des médecins. « Vouloir réguler aujourd’hui la totalité du système d’installation des médecins en France serait une folie, puisque le nombre de médecins diminue et va diminuer jusqu’en 2028 », a néanmoins prévenu Jean-François Longeot, sénateur du Doubs et président de la commission. De fait, les sénateurs préconisent de conditionner toute nouvelle installation dans le territoires les mieux dotés à un exercice partiel dans un territoire sous-dense médicalement. Ils souhaitent également confier aux médecins le soin de définir les modalités de cette obligation, sur le modèle d’autogestion des Allemands qui « sont meilleurs que nous » selon le président de la commission dans ce domaine. Si l’autogestion ne fonctionne pas, le législateur interviendra alors en dernier recours.
Autre proposition qui risque de susciter la polémique : cibler le remboursement de la téléconsultation aux soins non programmés avec son médecin traitant ou un autre médecin si l’urgence est constatée par un médecin régulateur d’un SAS (service d’accès aux soins) ou de la PDSA (permanence des soins ambulatoires) ou aux soins programmés avec son médecin traitant et seulement avec l’assistance d’un autre professionnel de santé (par exemple un pharmacien). D’ailleurs, les sénateurs recommandent de restreindre les aides à l’installation ou au fonctionnement des cabines de téléconsultation aux seules pharmacies situées dans les zones médicalement sous-dotées, en contrepartie d’une revalorisation de la rémunération.
Multiplier les lieux de formation
Pour la commission, la lutte contre les déserts médicaux passe également par la création de nouveaux sites de formation des futurs médecins en lançant « un plan d’ouverture d’urgence de facultés et d’antennes de facultés de médecine dans des villes de taille moyenne à proximité des zones médicales sous denses ». Ils recommandent également d’intégrer comme critère de sélection, le lieu de résidence des étudiants qui habitent dans les zones médicales sous denses lors de leur entrée en première année de Pass (Parcours d’accès spécifique santé) ou de LAS (Licence accès santé). Il est vrai qu’une étude de l’Insee, parue le 12 novembre, révèle que la moitié des médecins généralistes s’installent à moins de 3 km de leur université d’internat et que 57 % des installations ont lieu dans les grands pôles régionaux où réside 43 % de la population.
Une loi « pharmacien »
Outre une régulation partielle de l’installation des médecins, les sénateurs misent sur la délégation des compétences à d’autres professionnels de santé. Ils proposent par conséquent d’élargir les compétences des infirmiers avec une loi « infirmier » permettant la réingénierie de la profession. Cette loi, voulue également par la profession, est déjà dans les tuyaux mais a été retardée en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale. Dans cette même veine, la commission sénatoriale préconise aussi une loi « pharmacien » afin d’accorder plus de prérogatives aux pharmaciens d’officine. « La reconnaissance d’un rôle d’orientation du patient consistant en la prise en charge des « petits maux du quotidien » dans les zones sous-denses est une piste à envisager », est-il expliqué dans le rapport. Un meilleur accès aux soins passe également pour les sénateurs à l’ouverture de l’accès direct aux masseurs kinésithérapeutes pour un certain nombre de pathologies avec un droit à prescription d’imagerie médicale et de certains antiinflammatoires.
Une proposition de loi
« Aujourd’hui, on se rend compte que le tabou de la régulation chez les médecins n’est plus notre urgence, puisque l’on ne peut pas fournir le nombre de médecins dans les territoires. Le tabou, c’est de faire accepter par le milieu médical, la délégation de compétences aux infirmiers et aux pharmaciens », a souligné Jean-François Longeot, qui espère que ce rapport aboutira à une proposition de loi (PPL). Ce que n’ont pas attendu les députés. Une PPL transpartisane portée par le député socialiste de la Mayenne, Guillaume Garot, et soutenue par 92 députés, vise, selon France Info, à réguler l’installation des médecins généralistes et spécialistes, mieux intégrer les médecins étrangers et développer le salariat dans les centres de soins. La déconcentration des lieux de formation figure aussi dans ce texte. Les députés souhaitent instaurer une première année de médecine dans chaque département, avec des cours en distanciel. Reste à convaincre les médecins.
Magali Clausener








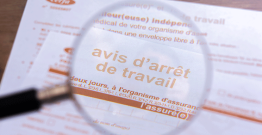










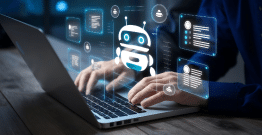










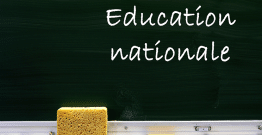







![[ép. 221 n° double] Responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) : bilan et changements](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-221-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-publics-rfgp-bilan-et-changements-300x161.png)
![[ép. 220] Handicap et fonction publique : 20 ans après…](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-220-handicap-et-fonction-publique-20-ans-apres-300x161.jpg)
![[ép. 219] Risques psychosociaux : prévenir, c'est aussi se protéger… soi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-219-risques-psychosociaux-prevenir-c-est-aussi-se-proteger-soi-300x161.png)