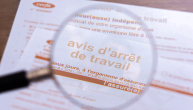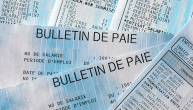Qui décide du placement des jeunes en famille d’accueil ?
Le placement en famille d’accueil d’un mineur, ou d’un majeur de moins de 21 ans, peut être décidé par le département par une procédure administrative ou, plus souvent, par le juge des enfants (JDE) par voie judiciaire.
Le placement judiciaire constitue une « mesure exceptionnelle de protection », prise en cas de « danger » de violences physiques sexuelles ou psychologiques, et de privations ou négligences graves. Le juge place alors sous la responsabilité du président du conseil départemental le jeune, confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE).
En France, 38 000 assistants familiaux (90 % de femmes) accueillent dans leur foyer des jeunes en difficulté. Ils sont recrutés par les départements ou, plus rarement, par des associations habilitées.
Quel contrôle de ces assistantes familiales ?
Pour pouvoir accueillir des jeunes, elles doivent détenir un agrément des services départementaux, valable cinq ans. Celui-ci est obtenu après enquête portant sur leur « projet de vie familiale » et le respect de conditions d’accueil garantissant « sécurité », « santé » et « épanouissement » aux enfants, explique la présidente de la Fédération nationale des assistants familiaux et de la protection de l’enfance Sonia Mazel-Bourdois.
L’agrément s’accompagne de formations obligatoires et, à terme, de la possibilité de passer le Diplôme d’État d’assistant familial (DEAF), créé en 2005. Il exempte ensuite d’agrément.
Les familles d’accueil font l’objet de « suivis réguliers », par un service d’accompagnement « professionnel » et par un agent départemental qui veille à la protection de l’enfant, explique le cabinet de Florence Dabin, Présidente du Conseil départemental de Maine-et-Loire et Vice-présidente de l’Association des départements de France (DF) en charge de l’enfance.
« Des contrôles sont effectués dès lors qu’un signalement est transmis ou lorsque des difficultés sont repérées », assure-t-on.
Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) néanmoins, plus des deux tiers des assistantes familiales en exercice déclaraient en 2021 n’avoir jamais été contrôlées.
Dans le procès de Châteauroux, 19 personnes sont jugées pour avoir accueilli sans agrément des mineurs : de 2010 à 2017, des dizaines d’enfants ont été confiés illégalement par l’ASE du Nord à une structure d’accueil située dans l’Indre, qui ne disposait pas de l’agrément nécessaire. Pour certaines de ces familles, un premier agrément avait même été retiré, après des condamnations pour agressions sexuelles sur mineurs.
Qui sont les jeunes en famille d’accueil ?
Fin décembre 2022, la Drees comptait 72 400 jeunes en famille d’accueil, soit 38 % de ceux confiés à l’ASE, un pourcentage en forte baisse sur la décennie (ils étaient 50 % en 2015).
Les jeunes confiés à l’ASE sont plus souvent des garçons et les 11-17 ans sont « surreprésentés » : presque la moitié. Parmi ces jeunes, le recours aux familles d’accueil est plus prégnant pour les plus jeunes (66 % des 3 à 5 ans).
Alors que le nombre de jeunes confiés à l’ASE a crû de moitié en 20 ans, Pierre-Alain Sarthou, directeur général de la Convention nationale des acteurs de la protection de l’enfance (Cnape), dépeint « un dispositif en manque de place ». « Les mesures de prévention et de soutien aux familles sont clairement insuffisantes et on arrive à des situations tellement dégradées (…) qu’il ne reste plus d’autre recours au juge que de placer », décrit-il.
Pourquoi ce mode d’accueil recule-t-il ?
En réponse, les services départementaux en sont réduits, selon lui, à un « court-termisme », conduisant « le plus rapidement possible à trouver une place quelque part » avec pour résultat, parfois, « des enfants ballottés ».
Tous les acteurs reconnaissent une « crise » du recrutement drainé par un manque d’attractivité et le « vieillissement » d’une profession qui peine à se renouveler.
En 2021, la moitié des assistantes familiales avaient 55 ans ou plus, menant « un deuxième métier et une deuxième vie ».
Le manque de places est également dénoncé par le Syndicat de la magistrature qui estimait fin 2023 à au moins 3 300 le nombre de « placements inexécutés », malgré une décision d’un juge.
Copyright © AFP : « Tous droits de reproduction et de représentation réservés ». © Agence France-Presse 2024




























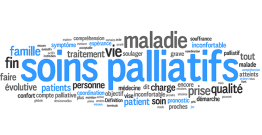
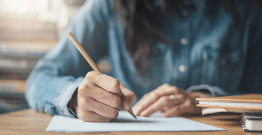








![[ép. 226] Les "trois devis" sont-ils, pour les achats de faibles montants, encore d'actualité ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-226-home-les-trois-devis-sont-ils-pour-les-achats-de-faibles-montants-encore-d-actualite-300x161.png)
![[ép. 225] Quelle réforme de la responsabilité pénale au lendemain du rapport Vigouroux ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-225-quelle-reforme-de-la-responsabilite-penale-au-lendemain-du-rapport-vigouroux-300x161.png)
![[ép. 224] Zoom sur les futures lois Eaux, Trace, mode de scrutin, PAPI, plastique, débits de boissons…](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-224-article-zoom-sur-les-futures-lois-eaux-trace-mode-de-scrutin-papi-plastique-debits-de-boissons-300x161.png)