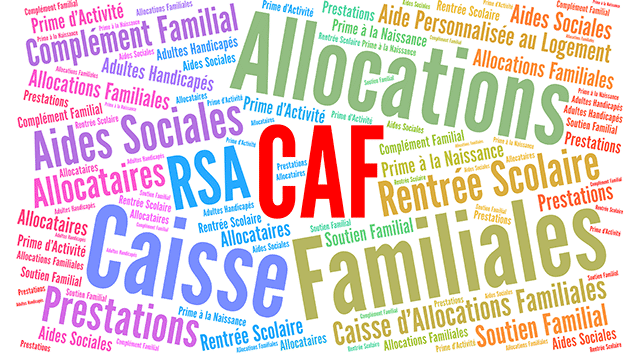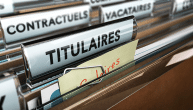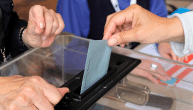Grâce à ces prestations, qui comprennent les minima sociaux, les allocations logement, les prestations familiales et la prime d’activité, le taux de pauvreté a atteint 14,6 % de la population en France métropolitaine, alors qu’il aurait atteint 22,2 % sans ces allocations, précise la Drees. Autrement dit, les prestations sociales réduisent le taux de pauvreté d’un tiers.
Pour les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 1 102 euros par mois pour une personne seule, ces prestations représentent 38 % de leur revenu disponible. Il s’agit ici d’allocations « non contributives », c’est-à-dire que le bénéficiaire les perçoit sans avoir dû cotiser au préalable : les prestations de l’assurance chômage ne sont pas prises en compte dans ce calcul. L’effet de la redistribution sur le taux de pauvreté est particulièrement marqué pour les familles monoparentales (- 20,7 points pour celles avec au moins deux enfants), pour les familles nombreuses (- 15,7 points pour les couples avec trois enfants), et pour les jeunes de moins de 20 ans (- 12,7 points).
Le nombre d’allocataires de minima sociaux, qui avait augmenté de 4,4 % en 2020, sous l’effet de la crise du Covid, a ensuite baissé de 3,5 % en 2021. Au total, en incluant les conjoints et enfants à charge, 7,1 millions de personnes sont couvertes par ces minima, soit une personne sur dix en métropole et une sur trois dans les départements d’Outre-mer (hors Mayotte).
Les parcours des bénéficiaires du RSA sont très hétérogènes : 20 % sortent des minima sociaux d’une fin d’année à la suivante, mais à l’inverse 22 % (parmi la tranche d’âge 35-64 ans) « ont passé les dix dernières années dans les minima sociaux ». Et quelque 40 % font des « allers-retours » vers et hors le RSA.
Copyright © AFP : « Tous droits de reproduction et de représentation réservés ». © Agence France-Presse 2022






























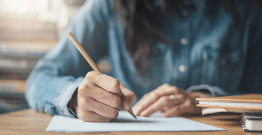







![[ép. 227] Eau et assainissement : un point sur la nouvelle loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-227-eau-et-assainissement-un-point-sur-la-nouvelle-loi-1-300x161.png)
![[ép. 226] Les "trois devis" sont-ils, pour les achats de faibles montants, encore d'actualité ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-226-home-les-trois-devis-sont-ils-pour-les-achats-de-faibles-montants-encore-d-actualite-300x161.png)
![[ép. 225] Quelle réforme de la responsabilité pénale au lendemain du rapport Vigouroux ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-225-quelle-reforme-de-la-responsabilite-penale-au-lendemain-du-rapport-vigouroux-300x161.png)