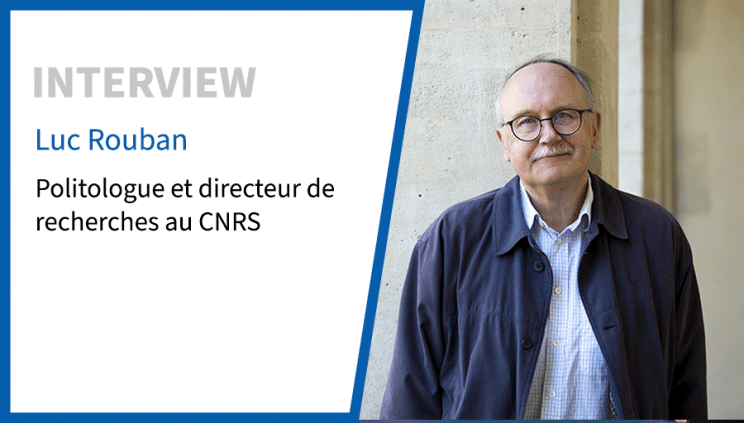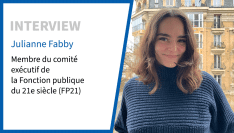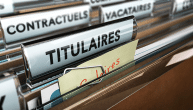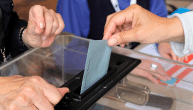Les résultats du dernier Baromètre de la confiance politique du Cevipof vous semblent-ils inquiétants ?
Nous avons publié en février la 16e vague de ce Baromètre qui constitue une importante enquête avec plus de 3 500 personnes interrogées en France. Elle est aussi comparative avec l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas. Pour la première fois, nous avons des résultats inquiétants concernant le rapport aux politiques et le degré de défiance. La France est devenue l’enfant malade de la démocratie en Europe, bien derrière l’Italie. On se retrouve avec des problèmes non seulement de confiance, mais aussi une très faible légitimité du gouvernement Bayrou. Et il y a surtout un rejet du politique jamais vu auparavant !
Finalement, la vie politique n’est plus jugée intéressante et pertinente quant à la vie quotidienne des Français. C’est la prolongation d’une crise continue qui dure depuis 2018 avec celle des gilets jaunes. Cela pose la question des fonctions publiques et des services publics. Ces derniers obtiennent toujours un niveau de confiance très élevé, sauf la justice. Mais globalement, on assiste à une demande d’efficacité et de transformation qui n’est pas satisfaite.
Ce constat est-il lié à vos travaux, publiés en décembre 2024, autour de la montée des populismes et des extrêmes qui touche aussi l’administration ?
Oui. Il existe un lien de cause à effet entre la question de l’efficacité, de la démocratie représentative et du vote pour le Rassemblement national. Avec les mêmes éléments d’explication que sont les problèmes de la mobilité sociale, du déclassement et de l’immigration. Cette dernière est devenue un point focal et l’incarnation d’une forme de mondialisation pas maîtrisée et pas contrôlée. C’est ce que l’on voit dans l’électorat du RN qui s’élargit de plus en plus aux classes moyennes et aux fonctionnaires. Les cadres du public votent désormais pour le RN à peu près comme ceux du privé. Ils sont aux alentours 20 %. Quant aux employés des fonctions publiques et ceux du privé, ils sont à 30 %. Le RN a également gagné du terrain chez les enseignants. Même si l’enseignement demeure le seul bastion de la gauche, l’ancienne gauche d’État.
Par ailleurs, la promesse républicaine n’est pas accomplie et la méritocratie n’est pas mise en œuvre. Dans le même temps, comme toute l’anthropologie politique française est construite autour de l’État, on observe un regard beaucoup plus critique sur le rôle de l’État et sa mission dans l’organisation de la hiérarchie sociale.
Nous sommes dans une situation très complexe en France qui ne se limite pas au mode de scrutin. Passer au scrutin proportionnel ne changerait pas grand-chose. La vraie question est celle du rapport à la vie quotidienne des Français et à l’efficacité de l’action publique. Cela se voit très clairement dans les territoires, et les élus nous le disent.
En ce moment, quel sujet retient particulièrement votre attention ?
L’arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Parce qu’il incarne quelque chose dont on trouve les éléments en France : le libéralisme autoritaire. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’électorat est largement de droite à l’issue des élections législatives de 2024.
Je simplifie un peu, mais un peu moins du tiers des électeurs votaient pour l’ensemble des candidats de gauche et 70 % pour le centre, la droite et l’extrême droite. Il y a une évolution et, en arrière-fond, une demande d’autorité qu’incarne Trump. La demande de libéralisme se traduit très clairement dans le Baromètre de la confiance politique avec une augmentation de plus de 11 % depuis l’année dernière. Face à une demande de réduction du nombre des fonctionnaires, on trouve une confiance assez grande dans l’entreprise, la réussite sociale qui se trouve plus dans le secteur privé que dans le secteur public. Des points relativement convergents à ce qui se passe aux États-Unis.
Dans un autre contexte, une grande partie de l’électorat français adhère de plus en plus à des thèses libérales. C’est-à-dire moins de fonctionnaires, plus d’entreprises et plus d’autorité avec un État qui affirme son rôle régalien. Cet effet Trump ne doit pas être négligé.
Selon vous, où en est-on des projets successifs de réforme de la fonction publique et de transformation de l’État ?
Les fonctions publiques sont toujours dans cette même crise endémique. Sauf qu’elle s’est accélérée. Il existe des éléments très précis d’appréciation comme la crise de l’attractivité des concours. Depuis les années 2000, sa courbe baisse sans cesse, et cela dans tous les secteurs. Le macronisme a prôné l’idée d’un rapprochement de plus en plus poussé – c’était le sens de la loi « TFP » de 2019 – entre la fonction publique et le secteur privé. Il fallait rendre les carrières plus polyvalentes et diversifiées. Ce qui demande beaucoup d’agents. Mais on est resté dans un entre-deux. Il y a eu la suppression d’un certain nombre de corps pour aller vers une logique de l’emploi, mais le reste n’a pas suivi. Nous sommes donc dans une situation où la règle du jeu n’est plus très claire pour les fonctionnaires.
Parmi les derniers ministres de la Fonction publique, Guillaume Kasparian souhaitait aller de plus en plus vers une privatisation de la relation d’emploi pour s’aligner sur ce qui se passe dans la plupart des pays européens. Mais il ne l’a pas fait car c’est compliqué, avec des sujets de fond qui ne sont pas réglés comme la hiérarchie sociale. À cela s’ajoutent une qualité du dialogue social souvent très mauvaise et une dégradation des conditions de travail. Sans oublier les agressions envers les agents comme les élus. Tout cela démontre une dégradation du statut symbolique de l’État. Beaucoup de fonctionnaires ne voient plus dans l’État qu’un mauvais employeur.
La qualité du service public en pâtit-elle ?
Cela dépend des secteurs. La qualité varie également en fonction de l’augmentation de la demande de service public et de sa réorganisation. Si les fonctions publiques attirent peu, le recrutement ne peut pas être de bonne qualité.
Autre sujet lié : la décentralisation. Dans l’Union européenne, la France reste le seul pays peu décentralisé. Ce qui n’est pas le cas de l’Allemagne à l’organisation fédérale, comme de l’Italie ou l’Espagne qui en sont très proches. Et ça marche souvent beaucoup mieux qu’en France.
La décentralisation est-elle la solution ?
Je pense que oui. Le Baromètre de la confiance politique montre que l’engagement politique ne tient plus. Les partis occupent la scène publique et médiatique, mais n’intéressent plus grand monde. Le nombre des militants s’est réduit. L’engagement dans les partis cède la place à un engagement associatif et dans des initiatives locales qui permettent vraiment une implication personnelle. Les gens veulent un leadership de proximité qui puisse répondre à leurs questions et les résoudre. Mais le système actuel ne permet pas de le mettre en œuvre. Il faut donc décentraliser, de manière beaucoup plus radicale, l’action publique au niveau local. L’enjeu sera de définir des échelons territoriaux cohérents, et de sortir des réformes de 2015.
Les grandes régions n’ont aucun sens, ni sur le plan culturel, ni sur le plan organisationnel. Des régions, de taille plus réduite en adéquation avec leur identité historique, devraient avoir de vrais moyens pour mettre en œuvre les politiques publiques. Il faudrait une responsabilisation des élus locaux qui ne seraient pas juste des gestionnaires dépendant du bon vouloir de l’État.
Que pensez-vous de l’agenda de ces prochains mois ?
On peut penser que le gouvernement Bayrou va stabiliser la situation. C’est l’intérêt de tous les acteurs politiques d’avoir au minimum un budget et une action gouvernementale relativement stable dans un univers très dangereux. On voit bien ce qui se passe en Ukraine, avec la mise à l’écart de l’Europe alors que ce débat nous concerne directement.
Par ailleurs, il y a l’idée de revenir à la logique politique de la Ve République. Le référendum peut avoir un rôle de compensation. Le retour au parlementarisme, que certains ont cru être la bonne réponse à la crise politique actuelle, ne constitue pas la bonne option. Les niveaux de confiance envers l’Assemblée nationale sont très bas. Les Français apparaissent très critiques à l’égard du comportement de la classe politique. Notre enquête montre de la défiance, mais aussi du dégoût. En attendant l’élection de 2027 pour vraiment trancher le débat, nous allons vivre une période provisoire et d’attente.
Propos recueillis par Jérémy Paradis, Rédacteur en chef de WEKA Le Mag
|
Biographie de Luc Rouban
|










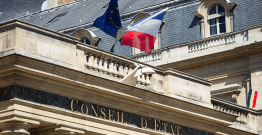














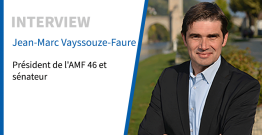












![[ép.229] DGS : piloter la fin du mandat](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-229-dgs-piloter-la-fin-du-mandat2-300x161.png)
![[ép. 228] Mode de scrutin en dessous de 1000 habitants : survol de la future loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-228-mode-de-scrutin-en-dessous-de-1000-habitants-survol-de-la-future-loi-1-300x161.png)
![[ép. 227] Eau et assainissement : un point sur la nouvelle loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-227-eau-et-assainissement-un-point-sur-la-nouvelle-loi-1-300x161.png)