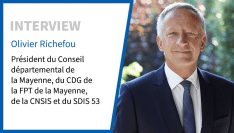Vous êtes l’un des grands spécialistes contemporains de la décentralisation. 40 ans après les lois de 1982-1983, quel regard portez-vous sur l’œuvre accomplie ?
Tout d’abord, je ne pense pas que la décentralisation ait commencé en 1982 (avec cette appellation simpliste d’« acte I » de la décentralisation). Le vrai point de départ est la Ve République, pensée dès le départ, comme devant signifier les restaurations de l’autorité de l’État avec une nouvelle organisation administrative incluant les collectivités territoriales, et de nouveaux rapports entre l’État et ces dernières (les premières réformes importantes sur ce que l’on appelle encore collectivités locales datent de 1959).
1982 est une nouvelle étape, où l’on se fait quelques illusions. Quarante ans après il n’est pas certain qu’il y ait eu le changement profond attendu ou voulu. Les collectivités devenues « territoriales » (bien que ce dernier terme puisse se discuter), sont certes plus puissantes qu’elles ne l’étaient ; l’avènement de la région a changé la donne, des transferts incontestables ont été effectués, les capacités d’intervention se sont accrues. Pour autant, il ne semble pas que l’État, lui, ait beaucoup changé : on peut douter de son efficacité comme de son efficience.
Depuis 2010, le pouvoir central cherche à créer des administrations locales « XXL », entre autres pour mettre fin au « law-shopping » consistant pour les opérateurs économiques à mettre les territoires en compétition, de façon à obtenir d’eux certains avantages, par exemple fiscaux. Que faut-il en penser ?
Ce n’est pas la fin de la concurrence entre les territoires, ou, à l’inverse, une concurrence exacerbée entre eux qui me paraît être l’élément le plus important. Le plus frappant est la volonté continue (sur ce point tout au moins) des pouvoirs publics de pousser à de plus grandes dimensions territoriales, avec des EPCI de plus en plus grands et des « grandes » régions. Tout ceci au nom de l’efficacité, en partant de considérations tirées de flux économiques et de population. Je ne suis pas du tout convaincu par une telle politique, qui a fait fi d’autres considérations toutes aussi importantes ; et, ce qui me frappe, plus que la question de la concurrence, c’est la contradiction entre la volonté proclamée de « proximité », en vantant les mérites, réels, de cette dernière, et la politique de la dimension toujours plus grande, les préoccupations d’économie (pas toujours avouées, et sur le résultat desquelles on peut être sceptique) étant essentielles.
« L’EPCI n’est pas nécessairement le bon échelon pour assurer le service public de proximité »
La notion très à la mode de service public de proximité relèverait parfois davantage du marketing territorial que d’une réalité tangible selon un rapport récent de la Cour des comptes sur le service universel postal. Parler de service public de proximité a-t-il encore du sens ?
Cette question est en lien avec la précédente. Selon l’article L. 1111-9 du CGCT, la commune ou l’EPCI est chargé d’assurer la fonction de « chef de file » pour ce qui concerne les « services publics de proximité ». Outre que l’on ne sait pas toujours très bien ce que recouvre cette fonction de chef de file (chaque catégorie de collectivités pouvant être chef de file dans les domaines énumérés par l’article précité), d’une part, il est vrai que les services publics de proximité sont essentiels à la vie de la population et sont une composante, ou un facteur, du lien social. D’autre part, l’État pousse systématiquement, par divers biais (notamment l’instrument financier ou fiscal) à ce que ce soient les EPCI qui soient en charge de ces services, alors que ce n’est pas nécessairement le bon échelon pour assurer le service : le bon échelon peut être la commune, ce peut être une institution autre qu’un EPCI.
L’État pousse à ce que ce soient les EPCI – de plus en plus grands, pas nécessairement cohérents – qui assurent cette prise en charge parce qu’il a supprimé, le plus souvent pour des raisons d’économies – et parfois pour des raisons de sécurité sanitaire, comme dans le cas de maternités – des services publics dans de nombreuses communes. Les services publics de proximité étaient souvent des services publics de l’État, au financement desquels participaient presque toujours les communes sur le territoire desquelles ils se trouvaient (cas des gendarmeries ou de la poste, par exemple).
« Le nombre élevé de communes en France est considéré depuis longtemps par les pouvoirs publics non comme une richesse mais comme un frein au développement »
Après la crise financière de 2008, les gouvernements successifs ont semblé chercher à dissoudre les communes dans les EPCI à fiscalité propre. La campagne électorale de 2022 et l’accent mis par plusieurs candidats sur la nécessité de rembourser le « quoiqu’il en coûte » semble annoncer la relance de ce projet. La commune telle que nous la connaissons n’est-elle plus indispensable ?
Le nombre élevé de communes en France – supposé trancher avec les autres pays comparables, notamment en Europe – est considéré depuis longtemps par les pouvoirs publics, non comme une richesse (malgré tous les discours en ce sens) mais comme un frein au développement. Ayant subi un échec (cuisant avec l’échec de la fusion autoritaire), les pouvoirs publics ont cherché à développer, avec succès, une stratégie de contournement avec les établissements publics de coopération.
Ces EPCI ont changé de nature et de dimension. S’agissant de cette dernière, cela paraît évident et l’on parle des « EPCI XXL ». Quant à leur nature, s’il s’agit toujours d’établissements publics, ils sont devenus une catégorie spécifique. Passons sur le fait qu’ils sont des établissements publics territoriaux, cela n’étonne plus personne et ne concerne pas seulement les établissements de coopération entre les communes. Le véritable changement, non reconnu en tant que tel, est le passage d’EPCI qui étaient des établissements de coopération à des établissements d’intégration, du fait de l’obligation (de droit ou de fait) pour les communes, d’appartenir à un EPCI à fiscalité propre, et de l’ampleur des compétences obligatoirement transférées à ces établissements par les communes.
Le système est devenu de plus en plus compliqué, donc de moins en moins lisible et compréhensible, malgré les efforts (provenant notamment du Sénat) pour simplifier, à travers plusieurs lois, le mécanisme des transferts de compétences. Les communes demeurent, même sur le plan économique, et plus encore dans les temps qui sont les nôtres, un échelon indispensable, pour une raison simple : les initiatives peuvent s’y développer plus facilement, l’observation de Tocqueville valant toujours de nos jours.
« Les lois successives ont accru les compétences des régions (loi NOTRe, loi 3DS) en instituant une sorte de centralisation à cet échelon »
Certains dénoncent aujourd’hui une recentralisation de l’État français. Qu’est-ce qui inspire ce reproche ?
On peut discuter des termes : s’agit-il d’une recentralisation, d’une centralisation maintenue, ou d’un refus de l’État d’abandonner ses prérogatives ? Trois points méritent d’être relevés brièvement.
Tout d’abord, la politique de décentralisation conduite depuis des années s’est bien traduite par des transferts de compétences, des transferts de services, des transferts de personnels. Cela aurait dû se traduire, logiquement, par une diminution du poids des administrations centrales, une réduction de leurs effectifs. Où sont-elles ? Quelques services ont bien été déplacés (forme de délocalisation) « en province » (pour les autorités parisiennes il y a bien toujours, d’un côté Paris, de l’autre la province, le terme ayant une connotation légèrement péjorative dans ce cas). Mais il n’y a pas eu de diminution significative de ces structures centrales. Le jour où elles seront véritablement réduites, peut-être pourra-t-on y voir le signe d’une véritable décentralisation.
Ensuite, et c’est un deuxième point, l’État a misé, à l’échelon infra-étatique (on ne peut pas dire « local » puisque ce terme serait vraiment inapproprié compte tenu de leur dimension) sur les régions. Celles-ci étaient indispensables, l’échelon régional nous manquait. Et la fonction des régions est d’abord économique, tout au moins au départ : en 1982, lors de la création des régions, on a cherché à leur donner des compétences qui, d’une part, n’empièteraient pas sur celles des communes et plus encore, des départements, et d’autre part, correspondraient à leur dimension territoriale plus étendue, soit une fonction de coordination. Les lois successives ont accru les compétences des régions (loi NOTRe, loi 3DS) en instituant une sorte de centralisation à cet échelon. La création de « grandes régions », qui ne sont qu’un réassemblage très critiquable, n’a fait qu’accentuer le phénomène, et la loi NOTRe (dont on aurait pu faire l’économie) a institué des mécanismes lourds, largement incompréhensibles, que les élus locaux ne se sont pas appropriés (CTAP et, plus encore, les conventions d’exercice concerté de la compétence) avec des « usines à gaz » qui ne font que se compliquer au fur et à mesure, malgré toutes les affirmations contraires.
Enfin, et c’est le troisième point, pour autant l’État n’a pas tiré profit de toutes ces évolutions, probablement parce que ceux qui l’animent n’ont plus une idée claire de ce qu’il est et de ce qu’il doit être. Il y a quelques années un rapport préconisait un « État stratège » et disait que le rôle de l’État n’était plus clair dans l’esprit des Français. Mais c’est d’abord dans celui des gouvernants qu’il n’est plus clair. Les dirigeants, pris globalement, diversifient les appellations, multiplient les types de structures, les réformes, mais sans avoir de vision à long terme du développement du pays dans tous les domaines, avec des tiraillements et des revirements.
Propos recueillis par Fabien Bottini, Consultant, Professeur à l’Université du Maine, Membre de l’IUF

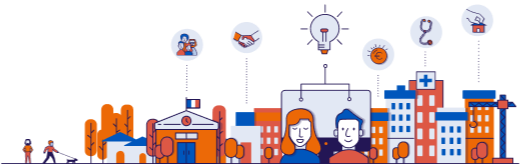




































![[ép. 217] Budgets verts : de quoi parle-t-on vraiment ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/01/ep-217-budgets-verts-de-quoi-parle-t-on-vraiment-300x161.png)
![[ép. 216] Commande publique : eForms, mode d’emploi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/01/ep-216-commande-publique-eforms-mode-d-emploi-300x161.png)
![[ép. 215] L'essentiel de l'actualité juridique durant la trêve des confiseurs](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/01/ep-215-l-essentiel-de-l-actualite-juridique-durant-la-treve-des-confiseurs-300x161.png)