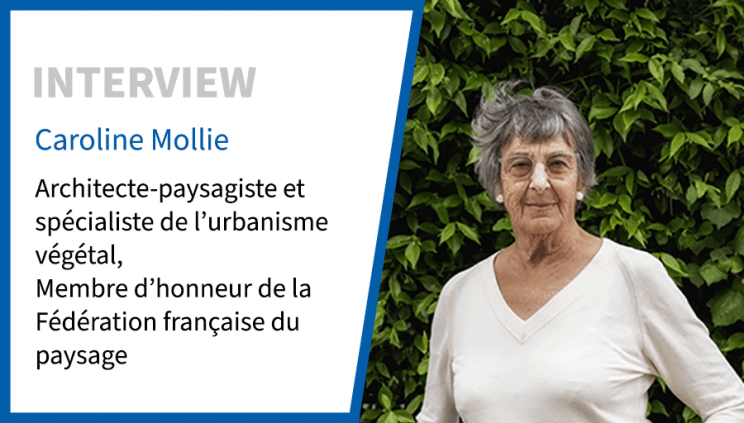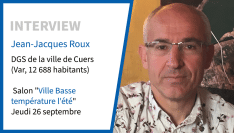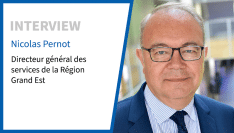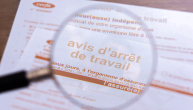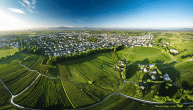Entretien avec Caroline Mollie, architecte-paysagiste et spécialiste de l’urbanisme végétal, membre d’honneur de la Fédération française du paysage, auteure de « Des arbres dans la ville » (Actes Sud, 2009) et, plus récemment, de « À l’ombre des arbres, planter la ville pour demain » (Delachaux et Niestlé, 2023).
Dans votre dernier livre, vous abordez l’histoire des arbres dans les villes : pouvez-vous nous raconter ?
De tout temps, les arbres ont été plantés dans les villes pour les embellir et simultanément créer des lieux de vie, abriter les jeux, les promenades, les marchés et les fêtes. Le plus bel exemple en est la transformation de Paris voulue par Napoléon III au XIXe siècle. La capitale est alors dotée d’une trame d’avenues plantées auxquelles sont associés des squares et des jardins en grand nombre. Les « Promenades de Paris » répondent simultanément aux besoins hygiéniques et récréatifs de l’époque et notamment à l’activité de promenade très en vogue depuis le XVIe siècle. Elles ont également pour objectif d’embellir la ville. Ce modèle rencontre un tel succès qu’il est appliqué dans toutes les grandes villes françaises.
Mais durant les « Trente Glorieuses », marquées par l’avènement du fonctionnalisme, les priorités sont données à la construction et à la circulation réduisant fortement la considération portée aux plantations urbaines. Simultanément, des techniques modernes telles la grande échelle et la tronçonneuse permettent de se libérer de tous les arbres qui entravent les projets, à moindre frais. Abattages et élagages drastiques deviennent monnaie courante.
Cet état d’esprit perdure encore trop souvent aujourd’hui, dans un contexte général de méconnaissance du vivant et de perte de savoir-faire. Il faut se réjouir néanmoins que la situation s’améliore, notamment dans des grandes villes : par exemple Lille, Strasbourg, Nantes, Lyon ou Angers, qui se sont dotées des compétences nécessaires.
Dans ce contexte, quelle vision de l’arbre dans la ville défendez-vous ?
J’appelle les arbres des villes les « arbres de compagnie », car ils n’apportent ni bois, ni fruits… Mais sont une présence dont on a besoin. Je pense que la règle des 3 – 30 – 300 devrait être appliquée partout : elle consiste à construire une stratégie garantissant que chaque habitant voie au moins 3 arbres de chez lui, ait une couverture arborée d’au moins 30 % dans son quartier, et un jardin à moins de 300 mètres. Mais il faut aussi changer de vision sur l’arbre et la manière dont on s’en occupe : un arbre, moins on le touche, et mieux il se porte. L’élagage « pour lui faire du bien » est une bêtise, il lui faut simplement de l’air, de la terre et de l’espace pour ses racines, et du temps pour se développer.
Je pense qu’il faut néanmoins un équilibre dans ce respect de la nature en ville. Je suis par exemple contrariée par la course à la biodiversité que certains prônent. Car si elle disparaît, c’est moins lié à la ville qu’au rural : abattage des haies, industrialisation de l’agriculture… La ville n’a jamais été l’endroit où la biodiversité se développe en priorité ! Alors si l’on plante et qu’elle s’y développe, c’est très bien. Mais en ville, il ne faut pas oublier que l’objectif, ce sont d’abord les citadins et leur besoin d’ombre et de lieux pour se retrouver.
Vous dites aussi que l’arbre qui est le « meilleur climatiseur naturel » que l’on ait trouvé…
Effectivement, l’Ademe a fait diverses études qui montrent que le meilleur moyen de rafraîchir la ville, c’est l’ombre des arbres. Cette évidence est confirmée par des études scientifiques qui intègrent des facteurs plus complexes. Je les cite dans mon livre. Pour ma part, j’y vois surtout du bon sens. Depuis toujours, l’été, l’humain comme l’animal se réfugient à l’ombre des arbres, nous construisons des pergolas devant les maisons… Se servir de l’ombre des arbres pour être au frais, c’est instinctif !
Pour vous, qu’est-ce qui fait obstacle à une présence accrue des arbres en ville ?
La ville est un milieu très contraignant pour un arbre : pour bien se développer et donner tout ce qu’il peut en termes de fraîcheur et de beauté, il a besoin d’espace pour ses racines et d’espace pour sa couronne. Il est aussi source de contraintes : il perd ses feuilles qu’il faut ramasser, fait venir les insectes. Face à ça, pour moi, il faut surtout un changement de point de vue : comme on accepte les tâches inhérentes au fait d’adopter un chat, si on veut des beaux arbres et de la fraîcheur, on en accepte les contraintes !
Ce changement de vision commence au moment du projet. Les plans doivent s’adapter aux besoins des arbres et non le contraire. Il faut s’assurer au préalable que les arbres auront suffisamment d’espace aérien et souterrain pour se développer. C’est trop souvent le contraire : par exemple, on dessine un alignement et l’on s’aperçoit à la plantation que le sol est trop encombré et ne permet pas de planter – ou alors dans des conditions qui fragiliseront l’arbre. Concernant l’entretien, c’est la même chose : élaguer un arbre avant qu’il ne perde ses feuilles pour ne pas avoir à les ramasser, ça le fragilise. Et c’est quand il est fragile qu’il peut, à terme, poser des problèmes – de dangerosité notamment.
Avez-vous des préconisations pour les villes souhaitant développer leur patrimoine arboré ?
Il y en a beaucoup… Mais je dirais surtout de s’entourer de personnes compétentes ! Planter un arbre, ce n’est pas juste aller dans une pépinière, prendre un arbre en bac et le mettre au milieu de la place : c’est un domaine, une science. Il y a des organismes de formation, des règlements, des écoles spécialisées. Je conseille aussi souvent le site du CAUE de Seine-et-Marne, dont l’une des spécialités est l’arbre d’ornement. Il faut aborder son patrimoine arboré avec quelqu’un de formé, qui sait donner des orientations liées au terrain : c’est une conversation éclairée.
Propos recueillis par Julie Desbiolles








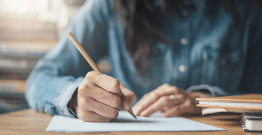








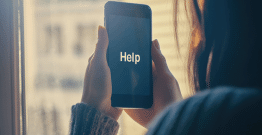












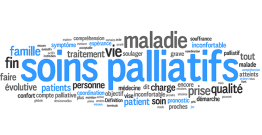







![[ép. 225] Quelle réforme de la responsabilité pénale au lendemain du rapport Vigouroux ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-225-quelle-reforme-de-la-responsabilite-penale-au-lendemain-du-rapport-vigouroux-300x161.png)
![[ép. 224] Zoom sur les futures lois Eaux, Trace, mode de scrutin, PAPI, plastique, débits de boissons…](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-224-article-zoom-sur-les-futures-lois-eaux-trace-mode-de-scrutin-papi-plastique-debits-de-boissons-300x161.png)
![[ép. 223] Marchés publics : les groupements d’opérateurs économiques, entre incertitudes et nouveautés](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-223-article-marches-publics-les-groupements-d-operateurs-economiques-entre-incertitudes-et-nouveautes-300x161.png)