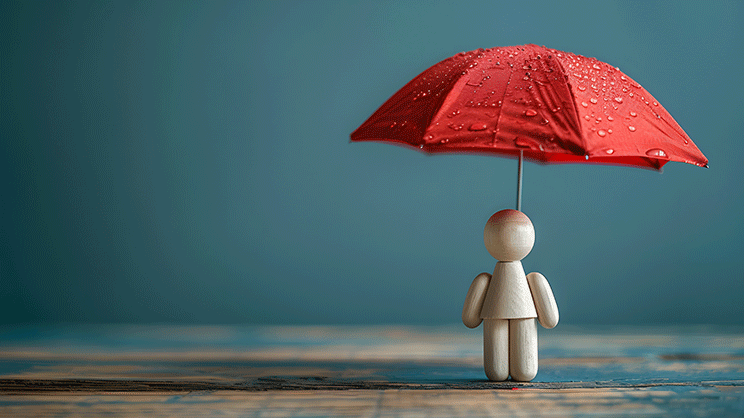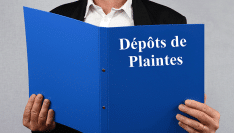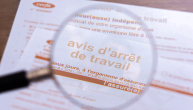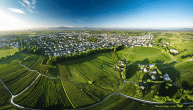Les résultats attendus par cette circulaire sont « la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière dans tous les cas de figure où l’employeur en a l’obligation : à titre préventif et en cas d’atteinte avérée, afin de garantir un climat de sécurité dans l’exercice des missions du service public de santé »2. La circulaire, contenant 27 pages annexes non comprises, est structurée en cinq parties et répond à plusieurs questions.
1. Qui peut bénéficier de la protection fonctionnelle ?
La circulaire rappelle que c’est un droit pour tout agent public de bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors qu’il est agressé physiquement ou verbalement lors de son travail, si cette agression est liée aux fonctions exercées.
La circulaire dresse la liste des bénéficiaires de la protection fonctionnelle :
- L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public ;
- Les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques ;
- Les étudiants de 2e et 3e cycle en bénéficient également ;
- Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, les praticiens hospitaliers universitaires en bénéficient ;
- Les collaborateurs du service public ;
- Les étudiants médicaux n’ayant pas atteint le 2e cycle des études et les étudiants paramédicaux en bénéficient, lorsqu’ils effectuent un stage en CHU ;
- Les aumôniers bénévoles et leurs auxiliaires, les agents publics exerçant ou ayant exercé leurs fonctions à l’étranger en bénéficient ;
- Les ayants droits, dans l’hypothèse où ils sont eux-mêmes victimes d’une atteinte à leur intégrité physique ;
- Le conjoint (incluant concubin ou partenaire PACSé) lorsqu’il engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’une atteinte volontaire ;
- Les personnels de direction.
2. Dans quelles conditions la protection fonctionnelle peut-elle être octroyée ?
La circulaire souligne que, sous réserve d’une situation d’urgence, l’agent victime doit démontrer la réalité des faits, le caractère intentionnel de l’attaque, son lien avec sa qualité d’agent public et l’effectivité du préjudice. Pour bénéficier de la protection fonctionnelle : le dommage doit trouver son origine dans les fonctions de l’agent elles-mêmes. La protection fonctionnelle n’a ni pour objet, ni pour effet d’obliger l’administration à intervenir dans le cadre de litiges opposant deux agents qui constituent des préoccupations d’ordre privé.
3. Comment accorder la protection fonctionnelle en cas de harcèlement ?
La circulaire indique que la charge de la preuve est allégée. Si un agent est présumé victime d’agissements répétés de harcèlement, l’administration est tenue de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle afin d’y mettre un terme. Si l’administration est dans l’incapacité d’infirmer ou de confirmer la suspicion de harcèlement et de faire la part des choses entre les accusations réciproques, la situation peut justifier que la protection fonctionnelle soit accordée aux deux agents. Elle peut s’avérer obsolète lorsque des mesures prises par l’administration ont été de nature à faire cesser la situation de harcèlement et que les éventuels dommages causés par les faits antérieurs ont été réparés.
4. L’administration peut-elle refuser d’accorder la protection fonctionnelle ?
La circulaire précise que l’administration peut refuser la protection fonctionnelle pour des motifs d’intérêt général, comme un conflit interne nuisant aux soins. La protection fonctionnelle n’empêche pas les poursuites disciplinaires, mais les frais de défense dans ce cadre ne sont pas couverts. L’agent doit informer sa hiérarchie et faire une demande écrite avec justificatifs avant d’engager une action en justice. Cette demande doit venir de l’agent lui-même. Si l’autorité ne peut statuer impartialement, elle doit saisir le directeur général de l’ARS ou le représentant de l’État. L’autorité compétente doit accuser réception et statuer dans les meilleurs délais. En cas de refus, la décision doit être motivée. Si la protection est accordée, les modalités de mise en œuvre sont précisées, avec une réévaluation possible au fil de la procédure judiciaire. La décision peut être retirée dans les quatre mois en cas d’illégalité ou à tout moment si obtenue par fraude.
5. L’administration peut-elle être responsable en cas d’insuffisance de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ?
La circulaire rappelle que l’employeur doit informer les agents sur la protection fonctionnelle et prendre des mesures en cas de menace. Une mise en œuvre insuffisante peut engager sa responsabilité. Ces mesures, qui peuvent être cumulatives, répondent à plusieurs objectifs : prévention et soutien, assistance juridique, prise en charge des frais, prise en charge des condamnations civiles, et réparation du préjudice subi. La circulaire cite la circulaire du 2 novembre 2020 qui précise la responsabilité des différents niveaux hiérarchiques dans le signalement des menaces envers les agents et stipule que toute négligence peut entraîner des sanctions disciplinaires. Ainsi, lorsqu’une menace est connue, les autorités doivent prendre des mesures pour protéger l’agent, comme changer ses coordonnées professionnelles ou, dans des cas graves, surveiller son domicile. L’administration doit aussi informer l’agent de son droit à une protection et des suites de son signalement.
6. Comment se traduit financièrement la protection fonctionnelle ?
La circulaire souligne que lorsqu’un agent bénéficie de la protection fonctionnelle, il ne doit pas avancer les frais et honoraires d’avocats. Si aucune convention n’est conclue, l’agent doit régler les frais directement. L’établissement doit vérifier l’exécution des prestations par l’avocat et la conformité des factures pour éviter tout détournement de fonds publics. Les agents doivent recevoir des autorisations d’absence rémunérées pour les convocations judiciaires, audiences, rencontres avec leur défenseur, et réunions liées à leur protection. L’administration prend en charge les condamnations civiles dues à des fautes de service et peut rembourser l’agent après coup. Les agents doivent informer leur établissement dès qu’ils connaissent une instance civile contre eux. L’administration indemnise les agents pour les préjudices subis (corporels, matériels, moraux) dus à des agressions ou harcèlements.
La circulaire souligne enfin que les établissements doivent prendre des mesures pour prévenir les attaques et aligner les actions de prévention avec celles de sécurité au travail. Ainsi, elle rappelle que des actions de formation, d’information et de sensibilisation doivent être développées pour protéger les agents.
Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public
2. Ibidem, p. 1.








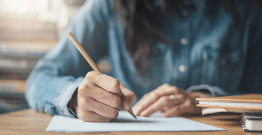








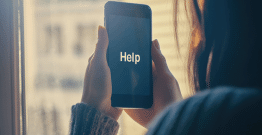












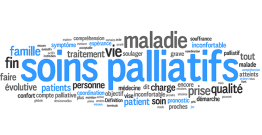







![[ép. 225] Quelle réforme de la responsabilité pénale au lendemain du rapport Vigouroux ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-225-quelle-reforme-de-la-responsabilite-penale-au-lendemain-du-rapport-vigouroux-300x161.png)
![[ép. 224] Zoom sur les futures lois Eaux, Trace, mode de scrutin, PAPI, plastique, débits de boissons…](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-224-article-zoom-sur-les-futures-lois-eaux-trace-mode-de-scrutin-papi-plastique-debits-de-boissons-300x161.png)
![[ép. 223] Marchés publics : les groupements d’opérateurs économiques, entre incertitudes et nouveautés](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-223-article-marches-publics-les-groupements-d-operateurs-economiques-entre-incertitudes-et-nouveautes-300x161.png)