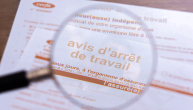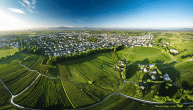Les projections budgétaires 2024-2027 relèvent d’une « fable », selon Johan Theuret et François Thomazeau, hauts fonctionnaires co-fondateurs du collectif Le Sens du service public. « La situation financière des collectivités locales fait depuis plusieurs mois l’objet d’un dialogue de sourds entre deux façons de considérer le débat, expliquent-ils dans une note* publiée par Terra Nova. La première vision s’intéresse à ce qui devrait être et porte sur les finances des collectivités un regard de nature plus volontariste et prospectif. La seconde s’intéresse au réel des finances locales uniquement ». Leur analyse se réfère à la loi de programmation des finances publiques 2024-2027 du 18 décembre 2023 et au programme de stabilité du ministère de l’Économie et des Finances d’avril 2024.
Alors que la crise budgétaire est marquée par un déficit public supérieur aux prévisions pour 2023 et 2024, avec un déficit record de – 6 % du PIB, le gouvernement pointe la responsabilité des collectivités locales dans la dérive des finances publiques. Or, les projections 2024-2027 reposent sur des hypothèses peu crédibles : contraction des dépenses de fonctionnement, réduction de la dette locale et stagnation des investissements – alors que la transition écologique exige un effort financier accru. Elles contrastent avec la réalité des finances locales, précise la note, qui rappelle l’augmentation des dépenses auxquelles les collectivités sont confrontées, liées à l’inflation, aux revalorisations salariales et à la hausse des cotisations sociales. Sans compter la croissance des investissements due notamment à la transition écologique et la perception de recettes fiscales moins élevées que prévu, causée par un ralentissement du marché immobilier et la baisse des droits de mutation.
La loi de programmation des finances publiques, qui tend à donner une vision pluriannuelle des dépenses et des recettes consolidées des administrations publiques, agrège l’évolution des comptes de trois sous-ensembles : l’État et ses opérateurs, les collectivités locales et leurs opérateurs, les administrations de sécurité sociale. D’où une certaine opacité. Par ailleurs, les orientations souffrent d’une absence de traduction opérationnelle, leur mise en œuvre reposant sur l’action conjointe de plus de 42 000 ordonnateurs gouvernés par le principe de libre-administration (35 000 collectivités et leurs syndicats). Enfin, elles ne tiennent pas compte des enjeux financiers liés au réchauffement climatique et à la transition énergétique.
Ces documents de programmation conteraient donc une fable budgétaire, selon laquelle les collectivités locales réaliseraient, sur les actions portées par leurs dépenses de fonctionnement, entre 2024 et 2027, un train d’économies « inédit depuis la décentralisation, dans des proportions qui nécessiteraient de toucher au périmètre des services publics locaux ». Les marges d’autofinancement ainsi dégagées seraient consacrées en priorité à leur désendettement, ce qui n’a jamais été observé par le passé, précisent les auteurs. Dans le même temps, les investissements resteront très modérés, dans des proportions incompatibles avec ce qui est attendu pour la transition écologique, et dont les effets récessifs semblent ne pas avoir été évalués.
Une loi de finances dédiée aux collectivités
Les auteurs rappellent qu’il est interdit aux collectivités locales d’emprunter pour financer leurs dépenses de fonctionnement ou rembourser leur dette. Si cette règle d’or leur évite de se trouver en faillite, elles peuvent toutefois enregistrer un déficit dû à l’endettement nécessaire à leurs investissements (qui sont un levier essentiel pour l’aménagement du territoire).
Face aux urgences budgétaires et climatiques, les auteurs en appellent à une « opération vérité » sur les comptes locaux, qui passe par de nouvelles expertises et des instances de pilotage renouvelées.
Plusieurs pistes seraient susceptibles d’améliorer le dialogue entre l’État et les collectivités. Pluriannualiser le pilotage des finances locales dans une loi de finances dédiée, indexée sur le calendrier des cycles municipaux et intercommunaux. Rendre plus explicites le rôle et la place des collectivités dans la stratégie macro-économique de l’État, et renforcer la transparence des données publiques sur les prévisions de l’État en matière de finances locales. Rendre publiques les hypothèses de prévision techniques « à mesures constantes » préparées par les services de l’État, en particulier celles applicables aux collectivités. Créer une instance tripartite indépendante de contre-expertise sur la prévision de finances publiques locales, composée de représentants de l’État (administrations et parlementaires), des associations d’élus et de l’expertise territoriale. Les auteurs proposent aussi de modéliser des trajectoires d’investissements publics compatibles avec les besoins identifiés pour les stratégies climatiques : stratégie nationale bas carbone, programmation pluriannuelle de l’énergie, plan national d’adaptation au changement climatique. Il conviendrait aussi de les mettre en cohérence avec la vision macro-économique des finances publiques.
Marie Gasnier
* Collectivités locales et réduction des déficits publics, l’impossible débat








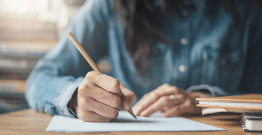








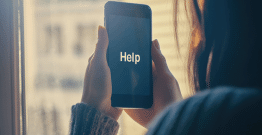












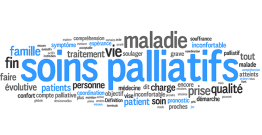







![[ép. 225] Quelle réforme de la responsabilité pénale au lendemain du rapport Vigouroux ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-225-quelle-reforme-de-la-responsabilite-penale-au-lendemain-du-rapport-vigouroux-300x161.png)
![[ép. 224] Zoom sur les futures lois Eaux, Trace, mode de scrutin, PAPI, plastique, débits de boissons…](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-224-article-zoom-sur-les-futures-lois-eaux-trace-mode-de-scrutin-papi-plastique-debits-de-boissons-300x161.png)
![[ép. 223] Marchés publics : les groupements d’opérateurs économiques, entre incertitudes et nouveautés](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-223-article-marches-publics-les-groupements-d-operateurs-economiques-entre-incertitudes-et-nouveautes-300x161.png)