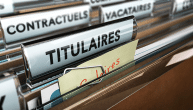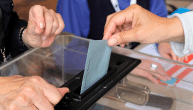Le préjudice résultant de la non-réalisation d’un minimum inclut le bénéfice net dont le titulaire a été privé et les frais inhérents aux personnels qui devaient être affectés à l’exécution du marché. Mais qu’en est-il du droit à indemnisation du titulaire en cas d’insuffisance de commandes au regard de l’évaluation prévisionnelle annoncée ?
Pas de droit à indemnisation pour insuffisance de commandes au regard de l’évaluation prévisionnelle annoncée
Un établissement public national avait confié à une société un marché public sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum ayant pour objet le transport non collectif du personnel de l’établissement. Pendant l’exécution du contrat, la société avait sollicité une indemnisation pour couvrir le préjudice résultant, pour elle, de la faiblesse des commandes par rapport aux prévisions. En effet, il avait été constaté une baisse de 17 % du nombre de missions par rapport aux prévisions, ainsi qu’une diminution encore plus marquée du nombre de personnes transportées, et des contraintes inattendues en termes d’horaires et de nombre de personnes en situation de handicap transportées. La société a ultérieurement informé l’acheteur qu’elle suspendait l’exécution des prestations contractuelles. L’établissement public l’a dès lors mise en demeure de reprendre cette exécution. La société a alors saisi le tribunal administratif d’une demande tendant, d’une part, à ce qu’il prononçât la résiliation juridictionnelle du contrat et, d’autre part, à ce qu’il condamnât ce dernier à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis.
Selon le juge administratif d’appel, il ne résulte pas que la baisse, relativement limitée, du nombre des missions confiées à la société, baisse qui a d’ailleurs justifié la conclusion d’un avenant destiné à rétablir l’équilibre économique du marché, aurait pu être anticipée par l’acheteur. Dans ces conditions, cette baisse ne suffit pas à établir l’existence d’une insuffisance dans l’expression, par ce dernier, de ses besoins. En outre, il n’est pas contesté que la baisse des bons de commande en 2020 est liée à la pandémie du Covid-19. Enfin, l’absence d’émission de bons de commande trouve son explication dans le litige opposant l’acheteur et la société qui avait informé l’établissement qu’elle suspendait l’exécution des prestations contractuelles. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la faiblesse des commandes adressées à la société par rapport à l’évaluation prévisionnelle, fournie dans le cahier des charges « à titre indicatif afin de permettre aux candidats de mieux évaluer leurs offres en fonction des besoins exprimés par l’établissement public », résulterait d’une mauvaise définition de ses besoins.
Une résiliation tacite validée en raison du comportement du titulaire
Les stipulations contractuelles se limitaient à laisser à l’acheteur public la faculté de résilier le contrat, sous réserve de l’indemnisation de son cocontractant, en cas de bouleversement des conditions d’exécution. Conformément aux principes généraux applicables aux contrats publics, l’acheteur public n’est tenu de procéder à une telle résiliation que dans le cas où un événement extérieur aux parties, de nature imprévisible et exceptionnelle, ferait irrésistiblement obstacle à l’exécution des prestations contractuelles. En l’espèce, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’acheteur aurait dû résilier le contrat et que, faute de l’avoir fait, il a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles et commis une faute lui ouvrant droit à indemnisation. Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, celui-ci doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique a mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles.
En ayant refusé expressément de répondre aux commandes transmises par l’acheteur, la société ne peut soutenir que l’absence d’émission de bons de commande, qui n’a fait que prendre acte du désengagement de fait de la société, révèlerait l’intention de ce dernier de résilier implicitement le contrat.
Dominique Niay
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 25 novembre 2024, n° 23MA01018, Inédit au recueil Lebon











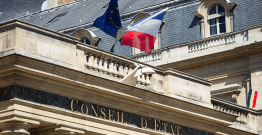















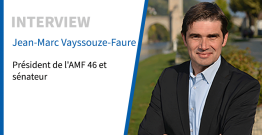










![[ép.229] DGS : piloter la fin du mandat](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-229-dgs-piloter-la-fin-du-mandat2-300x161.png)
![[ép. 228] Mode de scrutin en dessous de 1000 habitants : survol de la future loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-228-mode-de-scrutin-en-dessous-de-1000-habitants-survol-de-la-future-loi-1-300x161.png)
![[ép. 227] Eau et assainissement : un point sur la nouvelle loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-227-eau-et-assainissement-un-point-sur-la-nouvelle-loi-1-300x161.png)