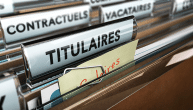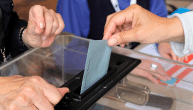Le ministère du Travail a confié en juin 2023 à un nouveau comité scientifique une deuxième évaluation de l’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD). Présidé par Yannick L’Horty et animé par France Stratégie et la DARES, ce comité a publié mi-octobre 2024 une première note d’étape pour dresser un état des lieux des travaux en cours et présenter un travail inédit permettant de caractériser les territoires expérimentateurs, les profils et trajectoires des salariés embauchés dans le cadre de l’expérimentation.
Visant à lutter contre le chômage de longue durée, l’expérimentation TZCLD mobilise l’ensemble des acteurs d’un territoire au sein d’un comité local pour l’emploi (CLE) pour proposer aux « personnes privées durablement d’emploi » des emplois en CDI au sein de structures appelées entreprises à but d’emploi (EBE). Déployée dans dix territoires entre 2016 et 2021, celle-ci a été élargie à plus de 50 territoires supplémentaires dans le cadre d’une deuxième phase, qui se déroule jusqu’en 2026. Ces territoires expérimentateurs ne sont pas sélectionnés en fonction de critères fixés sur des indicateurs socioéconomiques, mais sur la base d’un dossier de candidature examiné par le Fonds ETCLD.
Achevée en 2021, la première phase de l’expérimentation a fait l’objet d’une évaluation réalisée par un premier comité scientifique. Depuis juin 2023, un nouveau comité scientifique conduit donc l’évaluation de la deuxième phase de l’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD). La note d’étape qu’il vient de produire dresse un état des lieux des travaux en cours et présente un travail inédit permettant de caractériser les territoires expérimentateurs, les profils et trajectoires des salariés embauchés dans le cadre de l’expérimentation. Son rapport final est attendu pour l’été 2025. Le comité scientifique devra, en particulier, évaluer le coût du dispositif pour les finances publiques.
Des territoires hétérogènes
Ces travaux intermédiaires mettent en lumière l’hétérogénéité des territoires de l’expérimentation TZCLD en termes de surface et de taille de population, traduisant des implantations variées sur le gradient rural-urbain. Les territoires ont, en moyenne, une population estimée à 7 400 personnes. Ils sont également hétérogènes en termes socioéconomiques, mais le niveau de vie y est, en moyenne, plus faible que dans l’ensemble de la France et les ménages bénéficiaires du RSA y sont surreprésentés.
Des salariés aux parcours chaotiques
La note d’étape recense des informations sur les salariés embauchés dans des EBE depuis 2021. Ces salariés s’avèrent plus âgés que l’ensemble des salariés des secteurs public et privé : plus de quatre sur dix ont 50 ans ou plus contre trois sur dix pour l’ensemble des salariés. Ils sont aussi moins qualifiés : 23 % d’entre eux ont un niveau inférieur au CAP-BEP et 20 % un niveau supérieur au baccalauréat, contre respectivement 13 % et 45 % pour l’ensemble des salariés.
À l’embauche en EBE, un emploi sur deux est à temps partiel, nécessairement choisi dans le cadre de l’expérimentation, et six sur dix relèvent du champ des services directs aux particuliers. Les parcours des salariés avant leur entrée en EBE sont marqués par une alternance d’emplois – de courte durée et/ou à temps partiel – et de non-emploi. Si la moitié des salariés conventionnés en EBE n’ont jamais occupé d’emploi salarié dans les deux ans avant leur embauche, 17 % ont, en revanche, passé au moins un jour par mois en emploi salarié pendant plus de 12 mois. Près de 54 % des salariés ont été inscrits au moins 12 mois sur 24 en catégorie A à France Travail. Par ailleurs, un mois avant d’être embauchés en EBE, quatre salariés sur cinq étaient inscrits à France Travail. Et plus d’un tiers (35 %) ont eu recours au moins une fois au RSA ou à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au cours des 6 mois précédant l’embauche. « L’entrée en EBE les conduit, le plus souvent, à sortir du RSA et à bénéficier davantage de la prime d’activité », observent les auteurs de la note d’étape.











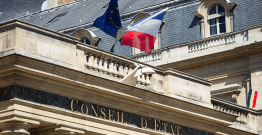















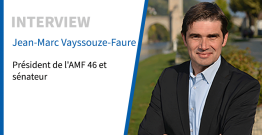










![[ép.229] DGS : piloter la fin du mandat](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-229-dgs-piloter-la-fin-du-mandat2-300x161.png)
![[ép. 228] Mode de scrutin en dessous de 1000 habitants : survol de la future loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-228-mode-de-scrutin-en-dessous-de-1000-habitants-survol-de-la-future-loi-1-300x161.png)
![[ép. 227] Eau et assainissement : un point sur la nouvelle loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-227-eau-et-assainissement-un-point-sur-la-nouvelle-loi-1-300x161.png)