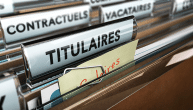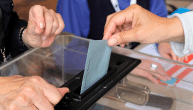« Cette réduction est d’autant plus forte que les parcours d’emploi sont fractionnés », a relevé dans une présentation à la presse le président du comité d’évaluation de la réforme, l’économiste suisse Rafael Lalive.
Le changement de calcul du salaire journalier de référence, qui détermine le montant de l’allocation, a accéléré le retour à l’emploi des personnes impactées, mais « a uniquement stimulé la reprise d’emplois peu durables », soit les missions d’intérim et CDD de moins de six mois, selon le rapport du comité publié par la Dares (direction des études du ministère du Travail).
« Du côté des salariés qui enchaînent les contrats courts et les périodes de chômage, nombreuses sont les personnes interrogées qui déclarent ne pas comprendre les principes qui sous-tendent le calcul de leurs allocations. Elles perçoivent cependant une dégradation générale de leurs conditions d’indemnisation », précise le texte.
Les allocataires concernés « sont peu qualifiés, peu diplômés, ils ont des emplois moins stables » et « sont plus souvent bénéficiaires des minima sociaux », a expliqué M. Lalive.
Concernant le relèvement de quatre à six mois de travail pour avoir droit à l’assurance chômage (condition d’affiliation), « on a un petit effet sur la durabilité des emplois, mais il est vraiment très léger », a ajouté l’économiste.
« Bonus-malus » neutre pour l’emploi
Parmi les pistes d’explication envisagées par les chercheurs sur ce manque d’effet, « les incitations à privilégier l’emploi durable ne sont pas toujours correctement perçues » faute d’explications par les conseillers de France Travail.
Enfin dans certains secteurs, « l’emploi durable n’est pas systématiquement préféré, ni par les employeurs, ni par leurs salariés », le recours à l’assurance chômage faisant office de « filet de sécurité », « dans des secteurs présentant des conditions de travail pénibles (horaires décalés, travail physique, éloignement des transports…) », selon le rapport.
À l’autre bout de l’échelle des salaires, la dégressivité des allocations à partir du 7e mois d’indemnisation pour les plus hauts revenus a réduit en moyenne de 20 jours leur durée de chômage, et même de 45 jours pour ceux dont l’allocation a été réduite de 30 %. De plus, « la dégressivité accélère le retour à l’emploi sans perte de salaire de base, ni modification des chances d’accéder à un CDI », ont constaté les chercheurs.
Pour cette population qui a retrouvé un emploi plus vite, la réforme a permis de réduire les dépenses d’assurance chômage de 35 % de plus que les 500 millions prévus par les seuls effets mécaniques, auxquels il faut ajouter jusqu’à 30 % de prélèvements supplémentaires (cotisations sociales et impôts).
Côté employeurs, dans sept secteurs gros utilisateurs de contrats courts, le système de bonus-malus en fonction du taux de séparation « n’a pas d’effet sur l’emploi » dans les entreprises concernées, rapporte Rafael Lalive, la baisse du nombre de fins de contrat étant contrebalancée par moins d’embauches.
Cette évaluation n’a pas pris en compte une autre réforme appliquée depuis 2023, qui module la durée d’indemnisation en fonction du taux de chômage (contracyclicité) et a engendré une réduction de cette durée de 25 %.
Copyright © AFP ; « Tous droits de reproduction et de représentation réservés ». © Agence France-Presse 2025































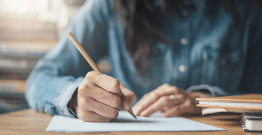






![[ép. 228] Mode de scrutin en dessous de 1000 habitants : survol de la future loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-228-mode-de-scrutin-en-dessous-de-1000-habitants-survol-de-la-future-loi-1-300x161.png)
![[ép. 227] Eau et assainissement : un point sur la nouvelle loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-227-eau-et-assainissement-un-point-sur-la-nouvelle-loi-1-300x161.png)
![[ép. 226] Les "trois devis" sont-ils, pour les achats de faibles montants, encore d'actualité ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-226-home-les-trois-devis-sont-ils-pour-les-achats-de-faibles-montants-encore-d-actualite-300x161.png)