1. Que prévoyaient les dispositions de l’article L. 2123-24-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ? Quel était l’objectif poursuivi par le législateur en 2019 lorsqu’il introduit cette disposition dans le CGCT ?

Les dispositions qui ont été annulées réservaient un droit aux seules communes de 50 000 habitants et plus : le droit de prévoir, dans le règlement intérieur du conseil municipal, que les indemnités perçues par chaque élu soient modulées en fonction de sa participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont il est membre, sans que la réduction de son indemnité ne puisse toutefois dépasser la moitié du montant normalement versé. Par l’effet de la décision du Conseil constitutionnel, ce droit est désormais ouvert à toutes les communes et à tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), quelle que soit leur population.
L’objectif poursuivi par le législateur en 2019 était très louable : il s’agissait, selon l’exposé des motifs de l’amendement, de « répondre à une demande sociale en faveur de davantage de transparence » et de « bâtir une relation de confiance entre les citoyens et leurs élus ». Il n’est pas certain que les termes de « transparence » et de « confiance » soient les plus adaptés, car il s’agit finalement moins, par la modulation des indemnités en fonction de l’assiduité, de contrôler les élus que de les responsabiliser, en sanctionnant ceux qui pourraient être tentés d’exercer leur mandat par intermittence et de ne pas honorer les convocations aux réunions des organes dans lesquels les électeurs leur ont donné mandat pour siéger.
2. Pourquoi la modulation du montant des indemnités de fonction des élus municipaux était-elle réservée aux seules communes de plus de 50 000 habitants ?
Votre question est au cœur du débat que soulevait la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soumise au Conseil constitutionnel. C’est parce que ce seuil de 50 000 habitants ne trouvait aucune explication que le Conseil constitutionnel l’a abrogé, au nom du principe constitutionnel d’égalité.
Il faut en effet rappeler que, pour le juge constitutionnel, la loi ne peut prévoir des règles différentes que si elles régissent des situations différentes ou pour des raisons d’intérêt général. Or personne n’a pu identifier de différence de situation entre une commune de 49 999 habitants et une commune de 50 000 habitants qui aurait justifié que seule la plus grande des deux puisse moduler les indemnités de fonction selon l’assiduité des élus. Dans les deux cas, les indemnités aux conseillers municipaux sont facultatives et, dans les deux cas, si le conseil municipal décide d’en verser, elles doivent être financées par ponction dans l’enveloppe des indemnités susceptibles d’être allouées aux maires et aux adjoints (à la différence de ce qui est prévu au-delà de 100 000 habitants). L’amendement à l’origine du seuil de 50 000 habitants n’apportait aucun éclairage et les débats en commission des Lois puis dans l’hémicycle non plus. Devant le Conseil constitutionnel, le Premier ministre a soutenu que le lien entre l’élu et le citoyen serait plus distendu dans les grandes villes que dans les plus petites communes, dans lesquelles la proximité faciliterait le contrôle des administrés sur l’implication des élus et rendrait donc moins nécessaire la modulation des indemnités de fonction selon l’assiduité. On pouvait douter du bien-fondé de cet argument, puisque la présence des élus aux réunions peut être contrôlée dans toutes les communes, par exemple en examinant les procès-verbaux. En tout cas, le Conseil constitutionnel n’a pas été convaincu. Il n’a pas identifié non plus de raison d’intérêt général qui aurait justifié que le droit à la modulation soit limité aux seules grandes villes.
Par l’effet de sa décision du 6 juin 2024, il a donc aboli ce privilège : la loi s’applique désormais aux quelques 35 000 communes au lieu de 120 auparavant.
3. La question prioritaire de constitutionnalité a été posée au Conseil constitutionnel par La Madeleine, commune de la Métropole européenne de Lille. Outre l’argument juridique de la différence de traitement injustifiée entre communes de plus ou de moins de 50 000 habitants, à quel(s) besoin(s) répond la nécessité – y compris pour les petites et moyennes communes – de pouvoir moduler les indemnités de fonction des membres du conseil municipal ?
Le droit de moduler les indemnités de fonction répond selon moi au besoin de garantir la qualité de la décision publique : notre démocratie représentative est fondée sur l’idée que les élus seront à même, par l’effet de leur délibération collective, d’identifier l’intérêt public local. Encore faut-il, pour qu’il en soit ainsi, que la délibération collective soit effectivement l’occasion d’échanger des arguments, donc que les élus formulent, contestent, en tout cas entendent ces arguments, et donc que les élus participent aux réunions !
Par ailleurs, nous avons tous pu mesurer l’effet dévastateur, dans l’opinion, que peut avoir l’image d’une assemblée à moitié vide, lorsque des indemnités de fonction, qui plus est versées sur fonds publics, sont accordées aux membres de ladite assemblée…
Évitons, dans une époque où nombre de ménages sont confrontés à des difficultés économiques, que se répande l’idée, délétère (et peut-être mortifère) pour notre démocratie, que les élus jouiraient de droits (notamment à une indemnité de fonction) sans devoirs (notamment de présence) en contrepartie. Pour autant, la décision du Conseil constitutionnel n’oblige pas les communes à moduler les indemnités de fonction, elle leur ouvre seulement le droit de le faire. Et pour celles qui choisiront de le faire, elles pourront définir, dans leur règlement intérieur, les conditions et l’ampleur de cette modulation, en prévoyant, par exemple, quels motifs d’absence seront valables.






























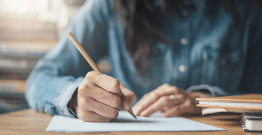







![[ép. 227] Eau et assainissement : un point sur la nouvelle loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-227-eau-et-assainissement-un-point-sur-la-nouvelle-loi-1-300x161.png)
![[ép. 226] Les "trois devis" sont-ils, pour les achats de faibles montants, encore d'actualité ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-226-home-les-trois-devis-sont-ils-pour-les-achats-de-faibles-montants-encore-d-actualite-300x161.png)
![[ép. 225] Quelle réforme de la responsabilité pénale au lendemain du rapport Vigouroux ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-225-quelle-reforme-de-la-responsabilite-penale-au-lendemain-du-rapport-vigouroux-300x161.png)
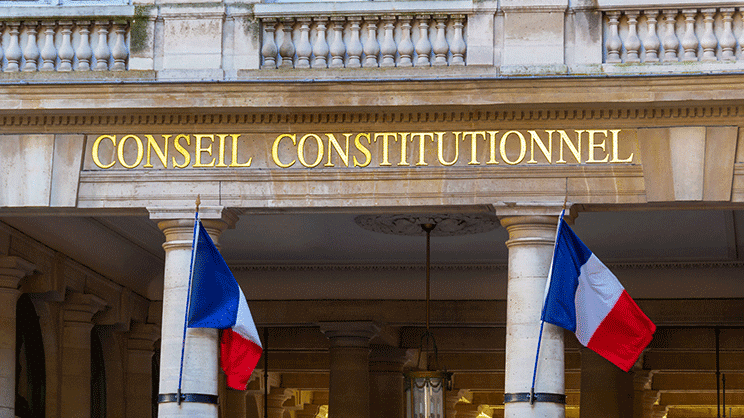








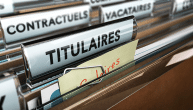
![[ép. 226] Les "trois devis" sont-ils, pour les achats de faibles montants, encore d'actualité ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-226-home-les-trois-devis-sont-ils-pour-les-achats-de-faibles-montants-encore-d-actualite-193x110.png)

