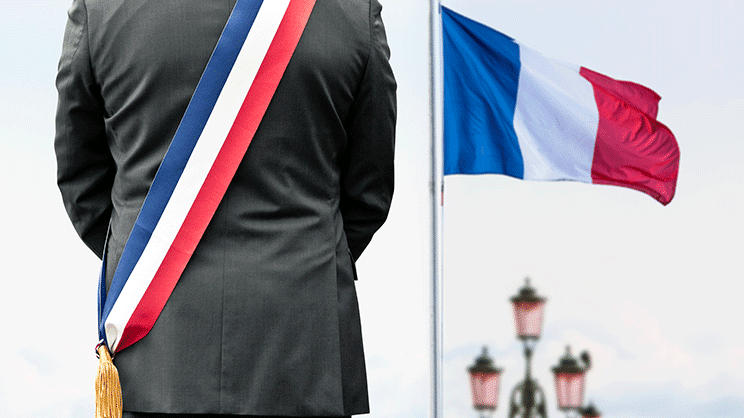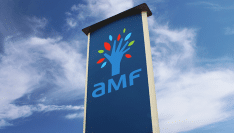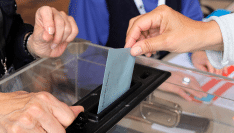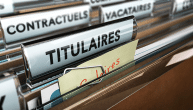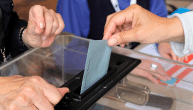Moins d’un an avant les élections municipales de mars 2026, 42 % des maires sortants sont prêts à renouveler leur mandat, selon une étude menée par le Cevipof* auprès de 5 200 maires. C’est une proportion comparable à celle qui avait été relevée en octobre 2019, où 48 % des maires pensaient se représenter cinq mois avant le scrutin. Quant aux autres, 28 % ne souhaitent pas réitérer (23 % en 2019) et 30 % n’ont pas encore pris leur décision (23 % en 2019). Malgré les difficultés du mandat en cours, qui avait débuté en pleine crise sanitaire, on ne peut donc pas parler de crise des vocations, a souligné Martial Foucault, professeur des universités à Sciences-Po et chercheur au Cevipof, lors de la présentation de l’étude, le 8 avril à Paris.
La taille de la commune influence nettement la décision : au-delà de 9 000 habitants, sept maires sur dix souhaitent se représenter en 2026, contre 37 % dans les communes de moins de 500 habitants. En revanche, plus le nombre de mandats successifs est élevé, plus le désir d’arrêter se manifeste. Alors que 46 % des maires veulent continuer après leur premier mandat, ils ne sont que 38 % après un deuxième mandat et 36 % après le troisième. Ce qui indique une lassitude devant la tâche, accentuée par le contexte difficile des dernières années, mais aussi un effet de l’âge – bien que 35 % des maires en place depuis cinq mandatures soient toujours prêts à servir leur commune.
Plusieurs raisons conduisent les maires à renoncer ou à hésiter à se représenter l’an prochain. En tête : le manque de ressources financières (17 %) et de personnel, surtout avancé par les élus des communes de moins de 500 habitants, mais aussi la trop grande exigence des citoyens (15 %) évoquée par les trois quarts des maires, toutes tailles de communes confondues. D’autres pointent l’envie de se reposer (seuls 33 % des élus retraités envisagent de se représenter contre 53 % de ceux qui sont en activité) ou d’autres raisons personnelles : sens du devoir accompli, sentiment d’insécurité et de surexposition face aux comportements des citoyens notamment. « Pour la première fois, en mars 2025, on constate une interruption de la hausse des violences à l’égard des élus », a précisé Martial Foucault. Toutefois, un quart des maires ont été victimes de cyber-harcèlement depuis 2020. Une très grande difficulté pour les élus, qui ont du mal à avoir le bon réflexe, entre présence sur les réseaux sociaux et nécessité de se préserver.
L’urbanisme, le sujet le plus difficile
La variété des sujets à gérer sans formation spécifique est compliquée pour la plupart des maires. Certains dossiers sont très difficiles. C’est le cas de l’urbanisme pour la moitié des élus, de la sécurité (42 %) et de l’aménagement de l’espace (38 %). À l’inverse, les activités en lien avec les citoyens et les autres élus nourrissent l’attachement des élus à la population et à l’histoire locale. Ainsi, ils vivent très positivement les cérémonies (84 %), inaugurations (77 %), rencontres informelles avec les habitants (75 %) ou encore le conseil municipal (70 %).
Finalement, bien que la fonction de maire soit usante – avec en moyenne 32 heures par semaine et 3 semaines de vacances par an —, « l’envie de servir et d’être utile demeure. « Il n’y a pas de crise, mais on doit donner encore plus envie aux jeunes de s’engager dans la vie municipale », a conclu le ministre de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation, François Rebsamen.
Martine Courgnaud – Del Ry
* en partenariat avec le ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation, les délégations aux collectivités du Sénat et de l’Assemblée nationale et les associations du bloc local : Association des Maires de France, Association des maires ruraux de France, Villes de France, Association des petites villes de France, Intercommunalités de France, France urbaine
|
Le sentiment de bonheur personnel influence la perception de la fonction de maire et donc l’envie de rempiler pour un nouveau mandat : les maires « heureux » sont trois fois plus nombreux à vouloir se représenter que ceux qui se déclarent « malheureux ». |









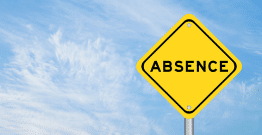














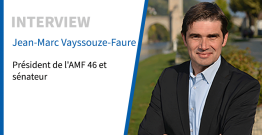













![[ép. 228] Mode de scrutin en dessous de 1000 habitants : survol de la future loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-228-mode-de-scrutin-en-dessous-de-1000-habitants-survol-de-la-future-loi-1-300x161.png)
![[ép. 227] Eau et assainissement : un point sur la nouvelle loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-227-eau-et-assainissement-un-point-sur-la-nouvelle-loi-1-300x161.png)
![[ép. 226] Les "trois devis" sont-ils, pour les achats de faibles montants, encore d'actualité ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-226-home-les-trois-devis-sont-ils-pour-les-achats-de-faibles-montants-encore-d-actualite-300x161.png)