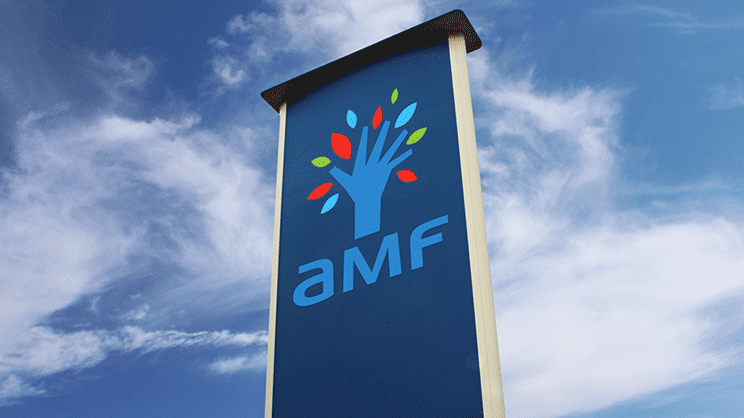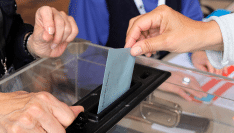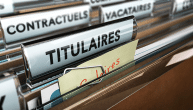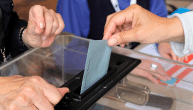Le mandat 2020-2026 a été difficile : crise du Covid, inflation, agressions d’élus, complexité croissante (juridique, administrative, réglementaire et financière), inflation de normes, exigences multiples des citoyens, mises en cause par l’État de la comptabilité locale… « Chaque mois depuis 2020, quarante-deux maires et de nombreux conseillers municipaux démissionnent, exprimant la difficulté croissante d’être élu local », a constaté le président de l’Association des Maires de France (AMF) et maire de Cannes, David Lisnard, lors d’une rencontre visant à mobiliser les élus sortants pour les prochaines élections municipales de mars 2026, le 1er avril dernier. L’engagement ou le réengagement des élus sortants reposera sur la liberté et les moyens d’action dont ils disposeront. L’AMF souhaite encourager les citoyens à participer à la vie de leur commune, non seulement en tant qu’électeurs mais aussi comme conseillers municipaux potentiels.
À douze mois des élections municipales, « le niveau de confiance des Français dans leur maire est exceptionnel, a rappelé Martial Foucault, professeur des universités à Sciences-Po et chercheur au Cevipof. Il atteint avec constance entre 65 et 68 % alors que celui des parlementaires approche péniblement 20 à 30 % ». Une hiérarchie dans la confiance politique qui « ne tombe pas du ciel ». C’est en cultivant le lien de proximité que les élus locaux consolident la confiance. Mais aussi, en adoptant une « compétence bienveillante ». C’est-à-dire qu’à leurs demandes variées, les citoyens attendent des réponses non seulement immédiates, mais également très individualisées, indépendamment du fait que cela peut contribuer à ne pas régénérer le contrat social. Bien que la parole publique locale reste à ce jour préservée, cela ne suffit pas à garantir la bonne vitalité de la démocratie municipale, a constaté le chercheur.
C’est toujours le maire qui tranche
On parle souvent d’une crise de la démocratie représentative. Mais, selon Martial Foucault, ce n’est pas la crise d’un système qui est en cause, mais plutôt celle des pratiques de la démocratie représentative. Ce qui montre, une fois encore, la différence entre niveau national et le niveau local. Lors des municipales de 2020, de nombreuses listes dites « citoyennes » sont apparues dans les villes de plus de 10 000 habitants, montrant un rejet de la démocratie représentative : la légitimité que le suffrage universel donne à l’élu ne suffirait pas. Pourtant, les maires sont ouverts à des formes complémentaires de démocratie, utilisables entre deux élections mais qui ne se substituent pas à la démocratie liée aux urnes. Ces exercices de démocratie délibérative ou participative, qui consistent à soumettre un projet à l’ensemble des habitants d’une commune, sont très compliqués à mettre en œuvre. En outre, il ne faut pas qu’ils affaiblissent pas ou délégitiment l’exercice de la démocratie représentative. Bien que, au final, il revienne au maire, élu et responsable devant les citoyens, de trancher. Avec la possibilité de faire cohabiter différents systèmes d’aide à la décision, on crée des espaces où l’on politise les enjeux, où les idées s’affrontent, ce qui est un signe de la bonne vitalité de la démocratie. Revers de la médaille : quand il n’y a plus d’arguments de part et d’autre, il faut bien prendre une décision. Et un risque existe, de voir contester le fait que les équipes municipales auraient utilisé toutes les voies de la démocratie municipale.
Confiance vis-à-vis du maire
Martial Foucault a également pointé la montée de l’individualisme dans toutes les relations sociales qui renvoie, selon lui, à la fin du fonctionnement des années 70 (la « post-modernité »). Cet individualisme se manifeste selon une demande d’autorité variable : réhabiliter l’autorité dans la vie publique, retourner à un ordre social beaucoup plus vertical… On voit poindre une forme d’illibéralisme : la possibilité qu’une démocratie ne repose pas seulement sur l’expression du pluralisme, le respect de la règle de droit et des élections libres. Qui a la légitimité la plus forte : le peuple ou celui qui détient l’autorité ? Les électeurs attendent aujourd’hui des politiques publiques qu’elles améliorent avant tout le bien-être individuel, dans tous les domaines : pouvoir d’achat, sécurité, logement, santé, retraites… Ce qui conduit à une forme de hiatus, car les citoyens connaissent souvent mal les domaines de compétences des communes, et ils attendent des équipes municipales d’intervenir sur des sujets qui n’entrent pas dans ce champ de compétences. Or, malgré une tension réelle, malgré une forme de déception, la confiance des Français vis-à-vis des maires n’est pas entamée. Le lien de proximité et la manière de traiter les sujets en bienveillance, montrent une relation interpersonnelle cruciale entre le maire et les citoyens.
Rajeunir les élus
Par ailleurs, au cours du mandat 2020-2026, on a pu noter un manque de reconnaissance des maires pour résoudre les crises. Progressivement, certains citoyens considèrent que pour mettre en œuvre des politiques publiques, l’égalité n’est pas le principe premier qui doit définir l’action publique locale. En lieu et place, les citoyens et les maires attendent l’efficacité, c’est-à-dire l’exigence du mandat qui lie les citoyens à leurs représentants.
Sur la question fondamentale de savoir s’il faut s’inquiéter d’une crise de l’engagement municipal (en 2020, 106 communes n’avaient pas trouvé de liste), Martial Foucault estime que cette tendance, certes, persistera. « Sur 35 000 communes, il y aura encore des listes difficiles à compléter, mais les élections seront organisées plus tardivement et les équipes municipales pourront être mises sur pied ». Ce qui l’inquiète davantage, c’est l’âge des élus : moins de 3 % des maires seulement ont moins de 40 ans. Il faut s’interroger sur ce qui, aujourd’hui, empêcherait une personne de 35/40 ans de s’engager dans la fonction de maire ? Or, en 2026, il devrait y avoir 40 % de nouveaux maires.
Le chercheur au Cevipof a conclu sur un élément optimiste pour l’avenir. La France est le seul pays au monde capable de rassembler sur les listes électorales un citoyen sur cinquante, soit 900 000 personnes. Un ratio de nature à garantir que le lien de confiance entre les citoyens et les élus municipaux doit être préservé. Car la société se construit par le bas.
Marie Gasnier
|
Quelles sont les dates des prochaines élections municipales ? Les élections municipales, prochaine échéance électorale, auront lieu en mars 2026. Sauf situation particulière, la date précise doit être fixée par un décret pris en Conseil des ministres qui est signé par le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur et le ministre des Outre-mer. Le texte est ensuite promulgué par le ministère de l’Intérieur au Journal officiel. La date précise doit être communiquée aux électeurs au moins 3 mois à l’avance selon l’article L. 227 du Code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu’ils ont été élus dans l’intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs ». |































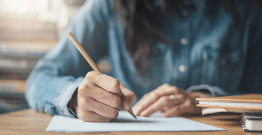






![[ép. 227] Eau et assainissement : un point sur la nouvelle loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-227-eau-et-assainissement-un-point-sur-la-nouvelle-loi-1-300x161.png)
![[ép. 226] Les "trois devis" sont-ils, pour les achats de faibles montants, encore d'actualité ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-226-home-les-trois-devis-sont-ils-pour-les-achats-de-faibles-montants-encore-d-actualite-300x161.png)
![[ép. 225] Quelle réforme de la responsabilité pénale au lendemain du rapport Vigouroux ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-225-quelle-reforme-de-la-responsabilite-penale-au-lendemain-du-rapport-vigouroux-300x161.png)