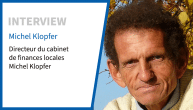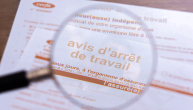Le pôle éducation de l’Institut des politiques publiques (IPP) a présenté, le 16 octobre 2024, une étude sur les mécanismes d’évitement scolaire. Ses deux auteures explorent un revers de la politique de la ville encore peu documenté : la stigmatisation territoriale, analysée sous le prisme de l’évitement scolaire des collèges publics situés dans les quartiers prioritaires. Elles soulèvent la question d’un effet « boomerang » de la labellisation en politique de la ville.
Leur étude s’appuie sur la réforme de la géographie prioritaire intervenue en 2014, qui a redessiné la carte des quartiers prioritaires. Sans que la carte scolaire ait été modifiée par la réforme, certains collèges sont ainsi « entrés » dans le périmètre de la politique de la ville et d’autres en sont « sortis ». La comparaison des collèges des quartiers situés juste au-dessus et au-dessous du seuil d’éligibilité, avant et après la réforme, permet donc d’évaluer l’impact de la labellisation du quartier en politique de la ville sur l’évitement scolaire.
« Les résultats font apparaître des effets de stigmatisation très significatifs pour les collèges publics qui sont entrés dans le périmètre de la politique de la ville », expliquent sans détour les deux auteures de l’étude. Après la réforme, la proportion de parents scolarisant leur enfant dans le collège de secteur a ainsi diminué, en moyenne, de 3,5 %. Cela correspond à une perte de six élèves par établissement à l’entrée en 6e.
Cette baisse, qui persiste jusqu’à cinq ans après la mise en place de la nouvelle géographie prioritaire, est due à des effets d’évitement scolaire généralisés, mais diffère selon le statut socio-économique ou la profession du parent référent. De fait, l’entrée du quartier dans le périmètre de la politique de la ville a augmenté de 3,6 % la propension des familles issues de catégories socioprofessionnelles favorisées (cadres, chefs d’entreprise, professions libérales, professions intellectuelles, enseignants) à éviter le collège de secteur pour inscrire leur enfant dans le privé, observe l’IPP. Pour leur part, les parents issus de catégories défavorisées (ouvriers et personnes sans activité professionnelle) se sont reportés vers les collèges publics situés en dehors du périmètre de la politique de la ville (+ 4,8 %). « Ces effets d’évitement différenciés selon le statut socio-économique tendent donc à accentuer la ségrégation sociale entre les établissements publics et privés avoisinants », commentent leurs auteures de l’étude.
Cette hausse de l’évitement scolaire des collèges publics des nouveaux quartiers prioritaires n’est pas liée à une diminution du nombre d’élèves résidant dans les secteurs scolaires affectés par la réforme de la géographie prioritaire. Les familles ont donc évité leur collège de secteur sans pour autant déménager pour changer de quartier, précise l’étude. Au sein du collège de secteur, l’IPP constate, également, une légère diminution des résultats au Brevet des collèges pour la première cohorte des 6e affectée par la réforme. Cette diminution illustre la recomposition sociale liée à la politique de la ville et suggère que les élèves ayant fait le choix de l’évitement étaient en moyenne d’un niveau scolaire légèrement supérieur. « Cela signifie également que, pour les élèves restés dans le collège de secteur, cet effet de recomposition a supplanté à court terme l’effet positif des politiques de soutien à la réussite scolaire ayant pu être mises en place dans les nouveaux quartiers prioritaires », analysent les deux auteures de l’étude. En revanche, elles n’enregistrent aucun regain d’attractivité pour les collèges qui sont sortis du périmètre de la politique de la ville. « Le revers de la géographie prioritaire apparaît donc d’autant plus difficile à dissiper que les parents ne semblent pas réagir en retour positivement à la suppression du label “quartiers prioritaires” », notent-elles.
Au final, « la géographie prioritaire engendre un phénomène d’évitement scolaire difficilement réversible », déplore l’IPP. Alors qu’une nouvelle révision de la cartographie de la politique de la ville est entrée en vigueur au 1er janvier 2024, l’Institut estime « essentiel » de poser la question de la pertinence des politiques « zonées », compte tenu de l’effet de renforcement de la ségrégation sociale scolaire mis en lumière par l’étude. « Étant donné les conséquences potentiellement négatives de cette ségrégation sur la réussite scolaire des élèves, ces résultats incitent à privilégier un ciblage direct des élèves en difficulté, plutôt que des quartiers et de leurs établissements scolaires », suggèrent les deux auteures en conclusion.








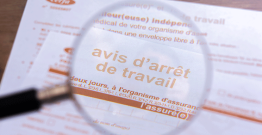










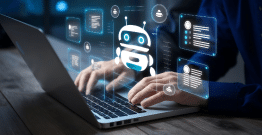










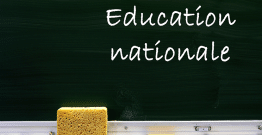







![[ép. 221 n° double] Responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) : bilan et changements](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-221-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-publics-rfgp-bilan-et-changements-300x161.png)
![[ép. 220] Handicap et fonction publique : 20 ans après…](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-220-handicap-et-fonction-publique-20-ans-apres-300x161.jpg)
![[ép. 219] Risques psychosociaux : prévenir, c'est aussi se protéger… soi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-219-risques-psychosociaux-prevenir-c-est-aussi-se-proteger-soi-300x161.png)