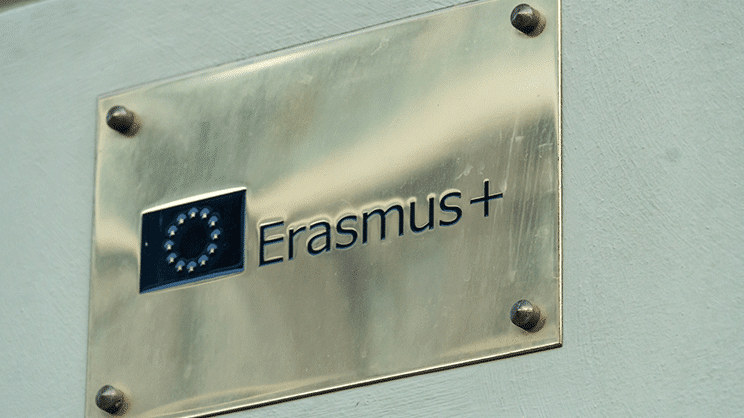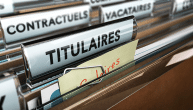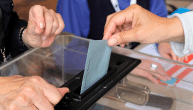« C’était la première fois que je partais à l’étranger. Ça a été une super expérience », témoigne Juliette Bisson, 17 ans, en bac professionnel menuiserie à Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours. Partie deux fois en Erasmus en première dans une école en Belgique et en stage en Italie, et une fois au Canada en terminale, elle dit « s’intéresser un peu plus » aux sujets européens.
Comme elle, plus de 14 millions de personnes en Europe sont parties depuis la création d’Erasmus en 1987.
À l’origine, ce programme permettait aux seuls étudiants de partir suivre une année de cursus à l’étranger. Devenu Erasmus+ en 2014 pour rassembler l’ensemble des anciens programmes dédiés à l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, il touche aujourd’hui aussi des élèves du primaire, du secondaire, de lycées professionnels, des apprentis, enseignants ou demandeurs d’emploi, avec des mobilités possibles dans 33 pays en Europe et 168 pays partenaires.
Selon un sondage CSA de 2022, Erasmus est la première réalisation de l’Union européenne citée par les Français. Ils fournissent les plus gros bataillons pour les départs, avec l’Espagne comme destination phare.
« Mobilités hybrides »
En 2023, près de 140 000 mobilités Erasmus+ ont été financées en France, avec une hausse très importante des demandes dans le secteur scolaire (+ 134 % sur un an) et forte dans la voie professionnelle (+ 33,5 %).
« La première priorité de ce programme pour ses fondateurs, c’était de faire des Européens », résume Nelly Fesseau, directrice d’Erasmus+ France. « L’esprit est toujours le même », ajoute-t-elle. Mais « progressivement le programme s’est ouvert ».
Aujourd’hui, plus de la moitié des bénéficiaires d’Erasmus+ en France partent en stage, comme Cécile Bertrand, 24 ans, qui a travaillé en Irlande dans un laboratoire sur les énergies marines, dans le cadre de son école d’ingénieur. Camille Balard, 28 ans, est allée aussi en Irlande, mais via Pôle Emploi, pour un stage de six mois dans une entreprise de marketing digital.
Les scolaires, eux, peuvent partir de la maternelle à la terminale, en groupe ou de façon individuelle. Les étudiants connaissent quant à eux de nouveaux types de mobilités.
Les alliances d’universités européennes, qui se développent depuis 2017, essaient « d’inventer des dispositifs nouveaux, de faire de la mobilité hybride (en partie virtuelle), des mobilités plus courtes, des mobilités professionnalisantes », explique Carle Bonnafous-Murat, délégué à Bruxelles de France Universités, qui rassemble les présidents d’établissements français.
« Programme plutôt élitiste »
Mais malgré son succès, Erasmus continue à ne concerner qu’une petite partie de la jeunesse européenne.
« On en est quand même un peu loin d’un programme extrêmement populaire », car « il touche moins de 10 % des étudiants européens », et « une part encore plus infime si on prend l’ensemble de la jeunesse », souligne Magali Ballatore, chercheuse en sociologie à l’université d’Aix-Marseille.
Pour elle, « c’est un programme plutôt élitiste », qui « va davantage toucher une jeunesse privilégiée », disposant d’un « capital culturel de type international », et évoluant souvent dans des formations sélectives (Sciences Po, écoles d’ingénieur, de commerce…).
« Erasmus reste le programme phare de l’action européenne », mais « il y a encore du chemin à faire » pour « arriver à une masse critique vraiment significative », renchérit Carle Bonnafous-Murat.
Une histoire de budget d’abord pour Nelly Fesseau, qui souhaiterait « dans l’idéal multiplier par trois le budget pour la prochaine période ». Il est estimé à 26,2 milliards d’euros pour la période 2021-2027 (déjà presque doublé par rapport à 2014-20), dont 2 milliards pour la France.
Elle plaide aussi pour le maintien des priorités actuelles, parmi lesquelles « l’inclusion » sociale, alors qu’Erasmus s’efforce de se démocratiser.
Pour Magali Ballatore, il ne s’agit cependant pas de faire « de l’inclusion à peu de frais ». « Ce qui serait dommage, c’est de dire à ceux qui en ont les moyens de faire des mobilités longues et de restreindre les autres à des mobilités courtes », prévient-elle.
Copyright © AFP : « Tous droits de reproduction et de représentation réservés ». © Agence France-Presse 2024











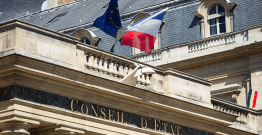















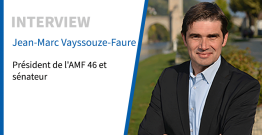










![[ép.229] DGS : piloter la fin du mandat](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-229-dgs-piloter-la-fin-du-mandat2-300x161.png)
![[ép. 228] Mode de scrutin en dessous de 1000 habitants : survol de la future loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-228-mode-de-scrutin-en-dessous-de-1000-habitants-survol-de-la-future-loi-1-300x161.png)
![[ép. 227] Eau et assainissement : un point sur la nouvelle loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-227-eau-et-assainissement-un-point-sur-la-nouvelle-loi-1-300x161.png)