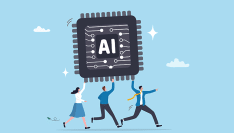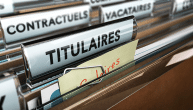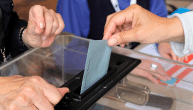Depuis l’apparition de ChatGPT fin 2022, l’intelligence artificielle (IA) se développe très rapidement et les collectivités commencent à l’expérimenter tous azimuts : information aux usagers, sécurité, gestion des déchets, optimisation du réseau de distribution d’eau, prévision des risques naturels, mobilité… Mais l’absence de recul et de mise en perspective sur l’IA a conduit la délégation aux collectivités locales du Sénat à lancer une mission d’information sur son utilisation « dans l’univers des collectivités territoriales ». Le rapport des sénatrices Pascale Gruny (Aisne) et Ghislaine Senée (Yvelines), que la délégation a adopté à l’unanimité le 3 mars 2025, propose un état des lieux des premières réalisations des collectivités, ainsi que des pistes méthodologiques « pour un recours adapté, éthique et durable à l’IA ». Avec l’intention de la « démystifier », et de la considérer comme un outil source de multiples opportunités.
Le rapport rappelle que, « contrairement à une idée préconçue qui pourrait facilement se diffuser dans le grand public à l’avenir, la réponse apportée par l’IA ne peut être tenue pour 100 % certaine ». Il reste toujours des marges d’erreur qui imposent de maintenir l’intervention et le contrôle humains comme condition essentielle d’un déploiement serein de l’IA. La méthodologie que les sénatrices préconisent pour les projets d’IA repose sur une stratégie en trois axes : développer une ingénierie, sécuriser et veiller au développement d’une IA éthique.
Il conviendra de développer la sensibilisation et la formation à l’IA des agents et des élus pour combler leurs importantes lacunes. En outre, élus locaux et cadres administratifs devront se former au droit de la conformité, applicable en matière d’IA et qui nécessite d’appliquer des processus sans procéder à aucune interprétation. Réussir l’introduction de l’IA au sein des services publics locaux passera aussi par l’implication des citoyens, afin de s’assurer qu’ils acceptent cette nouvelle technologie et pour éviter tout risque de déshumaniser les services.
Dans les collectivités d’une taille critique suffisante (sans doute 30 000 à 40 000 habitants), les sénatrices préconisent de créer un emploi à plein temps d’administrateur général des données (Chief Data Officer) pour gérer les données (« data »), mais aussi un réseau de référents data, un comité data ou une direction de la donnée.
Comités territoriaux de la donnée
Autre recommandation de la mission : expérimenter la création de « comités territoriaux de la donnée » pour faciliter le partage de données à des fins d’intérêt général et favoriser les échanges d’expériences. Créés à une échelle « pertinente » qui peut être différente selon les usages de données territoriales considérés (région, département, interco), ces comités auraient un rôle important : créer les feuilles de route pour identifier les cas d’usages prioritaires et les jeux de données à ouvrir plus rapidement, répartir les rôles entre les acteurs, assurer l’articulation entre les plateformes de mise à disposition des données… Les comités pourraient également animer le réseau des acteurs territoriaux de l’ingénierie en intelligence artificielle : collectivités, institutionnels et partenaires privés.
Les villes n’ayant pas toutes les mêmes compétences ni les mêmes ressources, il faudrait structurer le développement des projets autour de collectivités « cheffes de file » capables de construire une expertise et de monter des projets proportionnels aux besoins des territoires. Le rapport préconise que les collectivités qui le souhaitent établissent une charte éthique pour un bon usage de l’IA sur leur territoire. L’État pourrait créer une bibliothèque nationale numérique des projets IA des collectivités.
Selon Pascale Gruny et Ghislaine Senée, la complexité à laquelle les collectivités sont habituées (domaines de compétences multiples, foisonnement des règles de droit applicables, montage de cahier des charges compliqué…) est un atout certain pour réussir à gérer des projets d’IA. « À cet égard, la révolution de l’IA ne constitue qu’une marche, parmi d’autres, à gravir », constatent les sénatrices. Les collectivités peuvent s’appuyer sur une méthode de travail éprouvée, savent conduire des projets pilotes et des expérimentations : « un savoir-faire qui représente un atout fort en vue de l’introduction de l’IA au niveau territorial, gage d’efficacité et de gain de temps ».
Marie Gasnier
|
Gérer les délibérations avec l’IA Conçue pour rassembler les délibérations des collectivités, avec un moteur de recherche basé sur l’IA générative, la plateforme Delibia propose aux agents une assistance personnalisée pour une analyse et une rédaction plus rapides : requêtes filtrées (politique publique, association, type de projet…) et assistance rédactionnelle, à partir d’une base de données fermée de documents issus de 4 000 collectivités référencées. L’accès à Delibia est gratuit pour les collectivités de moins de 3 500 habitants. La start-up à l’origine du projet a été créée en 2021 à l’initiative de six collectivités normandes et du Pôle TES (pôle de compétitivité en innovation technologique en Normandie). |






























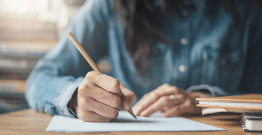







![[ép. 227] Eau et assainissement : un point sur la nouvelle loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-227-eau-et-assainissement-un-point-sur-la-nouvelle-loi-1-300x161.png)
![[ép. 226] Les "trois devis" sont-ils, pour les achats de faibles montants, encore d'actualité ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-226-home-les-trois-devis-sont-ils-pour-les-achats-de-faibles-montants-encore-d-actualite-300x161.png)
![[ép. 225] Quelle réforme de la responsabilité pénale au lendemain du rapport Vigouroux ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-225-quelle-reforme-de-la-responsabilite-penale-au-lendemain-du-rapport-vigouroux-300x161.png)