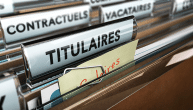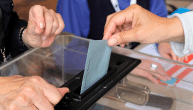Une durée unique pour un ensemble de services qui doit être justifiée
En l’espèce, une commune avait confié à une société la délégation de la gestion du stationnement public. Il comportait des services différents portant sur le financement, la conception, la construction et l’exploitation d’un parc de stationnement souterrain, un contrat d’affermage pour la rénovation, l’entretien et l’exploitation d’un autre parc de stationnement, et un contrat pour l’installation des équipements nécessaires au stationnement sur la voirie et leur exploitation. Ces contrats ont fait l’objet d’une même procédure de passation, ont été conclus à la même date pour une même durée de trente ans et poursuivaient le même objectif de répondre à un besoin de la commune en matière de stationnement, visant à atteindre un équilibre économique tenant compte de façon globale des investissements, des recettes et des charges prévisionnelles de toutes les activités liées au stationnement, sur la voirie et dans les parcs souterrains. Selon le Conseil d’État, s’il est loisible à l’autorité délégante de regrouper au sein d’un même contrat ou d’un unique ensemble contractuel des services différents et de les confier à un même opérateur économique, un tel choix ne saurait lui permettre de déroger aux règles qui s’imposent à elle pour la dévolution et l’exploitation de ces services. En particulier, la durée d’un tel contrat ou ensemble contractuel ne peut, sauf à méconnaître les dispositions de l’article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), excéder la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature des services, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers. Dans le cas où la délégation des différents services est prévue pour une durée unique qui n’apparaît pas justifiée pour chacun d’entre eux, une telle durée unique ne peut alors être valablement prévue que si l’exploitation conjointe des services considérés est de nature à assurer une meilleure gestion de ceux-ci et si la durée unique correspond à la durée normalement attendue pour que le concessionnaire puisse couvrir les charges d’exploitation et d’investissement de l’ensemble des services ainsi délégués, compte tenu des contraintes d’exploitation, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers.
Une contribution versée par le délégant qui ne doit pas être assimilable à une aide d’État
Par un arrêt du 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH (C 280/00), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que des subventions représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituaient pas des aides d’État, à condition de remplir quatre conditions cumulatives. Premièrement, l’entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies. Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent avoir été préalablement établis de façon objective et transparente, afin d’éviter qu’elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes. Troisièmement, la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable. Enfin, lorsque le choix de l’entreprise chargée de l’exécution d’obligations de service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public au sens des conventions soumises aux règles communautaires de publicité et de mise en concurrence, permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations. En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Douai (arrêt du 16 janvier 2024, req n° 22DA01936) n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce, en jugeant que la compensation versée en vertu du contrat commun dépasserait ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes ainsi que d’un bénéfice raisonnable du délégataire, pour en déduire que cette contribution n’avait pas le caractère d’une aide d’État.
Dominique Niay
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 17 mars 2025, n°492664, Publié au recueil Lebon














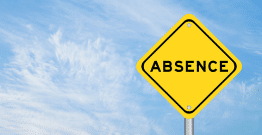










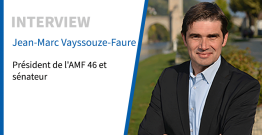












![[ép. 228] Mode de scrutin en dessous de 1000 habitants : survol de la future loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-228-mode-de-scrutin-en-dessous-de-1000-habitants-survol-de-la-future-loi-1-300x161.png)
![[ép. 227] Eau et assainissement : un point sur la nouvelle loi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/04/ep-227-eau-et-assainissement-un-point-sur-la-nouvelle-loi-1-300x161.png)
![[ép. 226] Les "trois devis" sont-ils, pour les achats de faibles montants, encore d'actualité ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/03/ep-226-home-les-trois-devis-sont-ils-pour-les-achats-de-faibles-montants-encore-d-actualite-300x161.png)