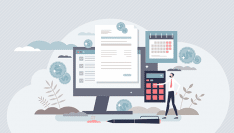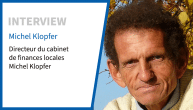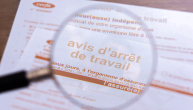Les réformes récentes des impôts locaux (2018 à 2023) ont modifié le lien territorial entre les collectivités et les contribuables, explique la Cour des comptes, dans un rapport publié le 15 janvier 2025. En effet, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a distendu le lien des ménages et entreprises avec les collectivités qui leur procurent des services. Toutes les catégories de collectivités sont touchées par ce phénomène, qui les incite notamment à limiter l’accueil de nouvelles activités économiques et la construction de nouveaux logements, puisqu’elles en tirent des retombées fiscales en baisse.
Ces réformes visaient à redonner du pouvoir d’achat aux ménages et améliorer la compétitivité des entreprises. Des objectifs atteints, selon la Cour « mais avec des effets incertains sur l’activité économique ». Et, outre la « déterritorialisation » des recettes des collectivités, ils s’accompagnent d’un coût considérable pour les finances publiques.
Ménages et entreprises contribuent à la couverture des charges des collectivités qui, en contrepartie, leur fournissent différents services : habitat, environnement, éducation, sport, culture, déplacements et possibilités d’expansion. Supprimer la THRP et la CVAE a réduit ou fait disparaître cette contribution. La contribution fiscale des entreprises est maintenue pour le bloc communal, mais pas pour les départements et régions.
Avec la suppression de la CVAE dans les recettes du bloc communal, les entreprises contribuent moins à couvrir les charges des intercos et des communes-membres, alors que les intercos sont compétentes de plein droit pour les aides à l’immobilier d’entreprise, et qu’elles peuvent compléter les aides accordées par les régions. Toutefois, les impôts fixés sur des bases foncières maintiennent un lien contributif étroit des entreprises avec les intercos et les communes où elles sont implantées : à travers la propriété d’immeubles et de terrains affectés à des activités économiques (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties) et l’utilisation de ces biens, par les entreprises qui en sont propriétaires ou qui les louent (cotisation foncière des entreprises). En revanche, les entreprises ne contribuent plus à couvrir les charges des départements.
Depuis la suppression de la taxe d’habitation, seuls les propriétaires contribuent au titre de la résidence principale ; le lien contributif des locataires avec la commune où ils vivent est rompu, bien qu’ils continuent à bénéficier des services locaux. La taxe foncière maintient néanmoins ce lien contributif dans la majorité des communes, qui comptent davantage de propriétaires que de locataires.
38 milliards d’euros en moins pour les finances locales
Dans les recettes de fonctionnement des communes et des intercos, les impôts territorialisés restent majoritaires (54,1 %). En 2023, les contribuables ont versé 100 milliards d’euros d’impôts locaux – 38 milliards d’euros de moins que si les réformes n’avaient pas eu lieu. Les ménages ont acquitté 54 % des impôts, contre 46 % pour les entreprises, une proportion stable par rapport à 2017. « Les pertes de recettes des collectivités ont été compensées par l’État selon des modalités qui leur sont plutôt favorables », estime la Cour qui précise que les collectivités ont bénéficié d’un gain financier net, grâce au dynamisme des recettes de TVA qui leur sont attribuées, en 2021 et 2022. Depuis, ce bénéfice se réduit.
Communes et intercos ont conservé des pouvoirs fiscaux étendus, qu’elles exercent en augmentant continuellement les taux des impôts locaux, ce qui a alourdi la charge des contribuables locaux de 2,9 milliards d’euros entre 2017 et 2023. En revanche, avec la réaffectation aux communes de la part départementale de la TFPB, les départements ont perdu l’essentiel de leurs pouvoirs fiscaux : tous ou presque appliquaient déjà le taux maximal des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), de 4,5 %. La réforme n’a pas eu d’impact significatif sur les pouvoirs fiscaux des régions qui n’en avaient quasiment plus.
Les impôts territorialisés sont devenus minoritaires dans les recettes de fonctionnement des départements (20,1 % en 2023) et des régions (12,1 %). Les entreprises ne contribuent plus à financer les compétences de développement économique des régions, ni celles des régions et départements en matière de transports (rail, routes), alors qu’elles en bénéficient.
Équité entre contribuables et entre collectivités
Selon la Cour des Comptes, il faudrait adapter la fiscalité foncière aux réalités économiques, en intégrant à court terme, aux bases de la TFPB, les résultats de la révision sexennale des valeurs des locaux professionnels arrêtées en 2017 et en engageant la révision, sans cesse reportée, des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation qui datent de 1970.
Elle recommande également de répartir les recettes de TVA en fonction de la richesse relative par habitant des collectivités, alors qu’actuellement cette répartition est proportionnelle à leurs pertes de recettes fiscales, ce qui désavantage les collectivités dont la population augmente.
Marie Gasnier








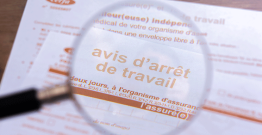










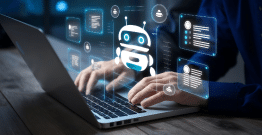










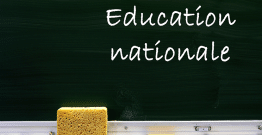







![[ép. 221 n° double] Responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) : bilan et changements](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-221-responsabilite-financiere-des-gestionnaires-publics-rfgp-bilan-et-changements-300x161.png)
![[ép. 220] Handicap et fonction publique : 20 ans après…](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-220-handicap-et-fonction-publique-20-ans-apres-300x161.jpg)
![[ép. 219] Risques psychosociaux : prévenir, c'est aussi se protéger… soi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-219-risques-psychosociaux-prevenir-c-est-aussi-se-proteger-soi-300x161.png)