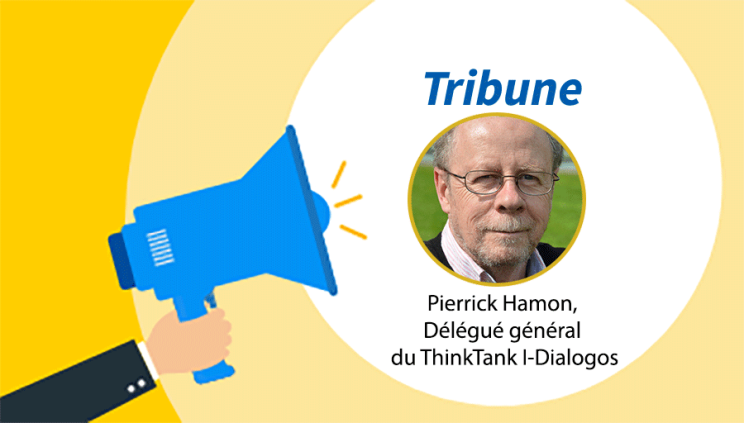L’évaluation des bases foncières en France repose, encore largement, sur des données anciennes, souvent issues d’une révision cadastrale qui date du 1er janvier 1970 – en 1969, alors étudiant, j’y avais participé, immeuble par immeuble, maison par maison, appartement par appartement. Cela crée aujourd’hui des écarts considérables entre la valeur réelle des biens immobiliers et leur valeur fiscale.
Ces données ne reflètent plus la réalité d’un marché immobilier qui a considérablement évolué en plus de cinquante ans. Elles peuvent même pénaliser certains propriétaires tout en favorisant d’autres, une injustice contraire aux plus élémentaires valeurs d’équité républicaine. C’est donc avec raison qu’Emanuel Macron a, dès 2017, supprimé la taxe d’habitation.
Des écarts importants entre communes
Cela signifie en effet que de nombreux logements ne sont pas correctement évalués ou même pas du tout déclarés, entraînant un « manque à gagner » fiscal significatif pour les collectivités locales. Dans beaucoup de villes en expansion rapide ou en transformation urbaine, cela peut inclure des sous-sols aménagés, des extensions non déclarées, ou même des constructions de logements qui échappent complètement aux services fiscaux.
En outre, le contribuable paye plus en fonction de son lieu de résidence qu’en fonction de la valeur de son bien. Les écarts entre communes pouvaient ainsi être considérables. De 13 % de la valeur locative à Puteaux à plus de 33 % à Lille. Ces écarts se sont alors accentués pour la taxe foncière.
Rattacher la taxe d’habitation aux revenus
Dès le début des années 90, Edmond Hervé, dans un rapport prémonitoire vite oublié et pour cause, recommandait, non sans courage, une profonde réforme de la fiscalité locale. Dans un article du journal Les Échos (12 mai 1998) l’ancien maire de Rennes soulignait avec force que « les valeurs locatives, valeurs indiciaires qui servent d’assiette au calcul de la taxe d’habitation, sont à l’origine de nombreuses et profondes injustices. Ces valeurs locatives auxquelles personne n’ose toucher, n’ont aucune justification économique. Même si cela risque de provoquer des effets de transfert sur certains ».
Edmond Hervé demandait que « soit prise en compte la capacité contributive réelle des contribuables ». Et il ajoutait : « En rattachant la taxe d’habitation aux revenus, ne serait-ce que partiellement, cela aurait une vertu à mes yeux, celle d’empêcher que le lien citoyens-contribuables continue de se distendre plus encore ».
Risques d’une jacquerie
Ce n’était certes pas sans risque électoral, ce que l’Association des Maires de France avait immédiatement compris en décidant de bloquer toute réforme fondamentale incluant une révision de l’évaluation des bases foncières. Cette indispensable mise à jour conduirait en effet et indubitablement, à une augmentation conséquente des prélèvements fiscaux pour nombre de contribuables locaux, y compris parmi ceux qui ne sont pas soumis à l’impôt.
Avec une taxe foncière qui a déjà augmenté de 20 % en cinq ans, moins à cause de la suppression de la taxe d’habitation que, surtout, du fait de la forte revalorisation de la valeur locative, le gouvernement a bien compris que cela pourrait provoquer une jacquerie autrement plus menaçante que celle des Gilets jaunes. Si l’équilibre entre responsabilité politique et pression électorale à court terme fait partie des tensions classiques dans les systèmes démocratiques, il atteint là son paroxysme.
Les leçons de l’exemple allemand
Chez nos voisins d’outre-Rhin, la fiscalité locale fait l’objet de discussions équilibrées au sein du Bundesrat, qui représente les Länder (États fédérés). Il s’agit d’un vrai Sénat. Les décisions concernant la fiscalité locale, y compris les taxes foncières, y sont négociées entre le gouvernement fédéral et les représentants des collectivités locales. Cette structuration fédérale, qui manque à la France, permet une plus grande transparence et un meilleur équilibre entre les niveaux de pouvoir. Les collectivités allemandes ont ainsi davantage de poids et responsabilité dans la répartition des ressources fiscales, ce qui réduit les blocages observés en France où les communes dépendent fortement des décisions prises par l’État central tout en ayant une grande liberté fiscale…
La question n’est donc certainement pas celle du retour à la taxe d’habitation, mais bien celle d’une vraie réforme fiscale incluant, auparavant et en priorité, une complète actualisation des valeurs cadastrales du 1er janvier 1970.
Par Pierrick Hamon, Délégué général du ThinkTank I-Dialogos et ancien fonctionnaire territorial






































![[ép. 219] Risques psychosociaux : prévenir, c'est aussi se protéger… soi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-219-risques-psychosociaux-prevenir-c-est-aussi-se-proteger-soi-300x161.png)
![[ép. 218] Intelligence artificielle et achat public : solutions, risques, perspectives](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/01/ep-218-intelligence-artificielle-et-achat-public-solutions-risques-perspectives-300x161.png)
![[ép. 217] Budgets verts : de quoi parle-t-on vraiment ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/01/ep-217-budgets-verts-de-quoi-parle-t-on-vraiment-300x161.png)