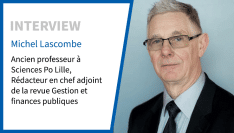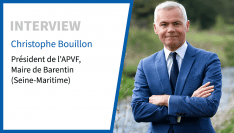Un effort de 5 Mds € est demandé aux collectivités. Le fonds d’épargne imposé aux 450 collectivités les plus importantes, avec 2,8 Mds €, est encore flou. Comment le considérez-vous à France Urbaine et quels amendements avez-vous tentés ?
Tout d’abord, ce n’est pas 5, mais 8,5 Mds € qui sont de fait demandés aux collectivités : il faut en effet ajouter la réduction de 60 % du Fonds vert, une baisse des variables d’ajustement de 487 M € dix fois supérieure à celle de 20241, la hausse du point d’indice sur 3 ans (1,5 Md pour 2025 seulement). 8,5 Mds € en un an, c’est trois fois plus que la baisse des dotations de 3,3 Mds €/an en moyenne entre 2015 et 2017. Ces efforts visent à réduire la dépense de l’État.
Sur le fonds d’épargne, Bruxelles accuse la France de ne pas respecter le programme de stabilité qu’elle a transmis au printemps 2024 à la Commission européenne et lui demande de crédibiliser la maîtrise de l’évolution des dépenses des collectivités. C’est pourquoi Bercy a coupé le robinet de 2,8 Mds € : l’objectif n’est pas en réalité ici de diminuer la dépense de l’État. C’est une consignation : on bloque l’argent qu’on ne rendra peut-être pas de manière individuelle, mais qu’on utilisera sinon pour abonder le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)… alors que ce fonds ne peut pas augmenter selon le rapport d’octobre 2021 des sénateurs Guené et Raynal2.
Souvent, France Urbaine fait des amendements de repli ou d’amélioration. Mais ce fonds est tellement absurde que nous avons tout simplement demandé son abandon. C’est une ponction a priori, et non a posteriori comme pour le contrat de Cahors. Prélever 2 % des recettes des collectivités amputera leur autofinancement et impactera à terme les investissements. Mais les investissements sont des coups partis. Pour les financer, il faudra donc recourir à l’emprunt… alors que l’objectif initial est le désendettement ! Il est également inepte de cibler les collectivités locales au seul motif qu’elles sont grosses. Certaines villes de tous bords dont l’épargne nette était négative ont en début de mandat réduit les services publics et/ou augmenté la pression fiscale. Quelques années après, l’État fait un hold-up sur ces économies. Mais les conséquences de cette stratégie seront pour tous : les départements supprimeront les aides aux communes, les intercos ne programmeront plus d’équipements pour leurs communes périphériques. Les six associations du bloc local rappellent dans un communiqué commun l’attachement au « principe d’équité qui les lie » : si on affecte un niveau, cela impacte les autres.
La baisse des dépenses des collectivités amènera-t-elle aussi la suppression de certains services ou politiques publiques, des économies de fonctionnement, le non-renouvellement de certains personnels… ?
Je n’ai pas de boule de cristal, mais avec la baisse des dotations en 2015-2017, les économies, pour les membres de France Urbaine, ont porté à 50/50 sur les politiques publiques et sur leurs dépenses propres. Oui, certains efforts ont alors été bénéfiques : achats collectifs, cessions de patrimoines non valorisés, remises en cause de certaines DSP coûteuses, etc. Mais est-ce possible à nouveau ? Après avoir maigri, les collectivités n’ont plus de gras !
20 départements sensibles sont écartés du fonds d’épargne. N’y a-t-il pas des agglos ou villes aussi en difficulté ?
Sur les 600 collectivités locales dont le budget dépasse 40 M € de dépenses par an et donc potentiellement concernées par le fonds d’épargne, 165 en sont sorties en l’état actuel de l’article 64 du PLF. Parmi les 250 communes à la DSU cible, 15 villes – dépassant les 40 M € de budget – sont exclues du prélèvement.
La taxe foncière ne va-t-elle pas exploser pour compenser, alors qu’elle a déjà beaucoup augmenté depuis le début de mandat ?
En début de cycle électoral, il y aurait eu ajustement, mais avec les élections municipales de 2026, je n’y crois pas. C’est pourquoi cette ponction de 2 % se traduira par une baisse de l’autofinancement et une progression de l’endettement.
Frédéric Ville
1. Les variables d’ajustement sont des concours financiers de l’État compensant d’anciens allègements (Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle).
2. Même si à Intercommunalités de France ou à l’Association des maires ruraux de France, des voix demandent toujours son augmentation.
|
Inscription gratuite et obligatoire |
|
Le 24 octobre 2024, la Délégation aux collectivités territoriales du Sénat recevait le vice-président du Comité des finances locales, Jean-Léonce Dupont, Boris Ravignon, auteur d’un rapport sur les Coûts des normes et de l’enchevêtrement des compétences entre l’État et les collectivités et Éric Woerth, pour son rapport « Décentralisation : le temps de la confiance ». Après les perspectives peu réjouissantes du PLF, tous ont esquissé à plus long terme des pistes de réflexion – pas toujours concordantes : une part de CSG avec pouvoir de taux, une part de l’impôt sur les sociétés territorialisable et une dotation de solidarité au lieu des DMTO pour les départements, suppression de certaines agences de l’État, économies sur les normes et l’enchevêtrement des compétences… |






































![[ép. 219] Risques psychosociaux : prévenir, c'est aussi se protéger… soi](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/02/ep-219-risques-psychosociaux-prevenir-c-est-aussi-se-proteger-soi-300x161.png)
![[ép. 218] Intelligence artificielle et achat public : solutions, risques, perspectives](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/01/ep-218-intelligence-artificielle-et-achat-public-solutions-risques-perspectives-300x161.png)
![[ép. 217] Budgets verts : de quoi parle-t-on vraiment ?](https://www.weka.fr/actualite/wp-content/uploads/2025/01/ep-217-budgets-verts-de-quoi-parle-t-on-vraiment-300x161.png)